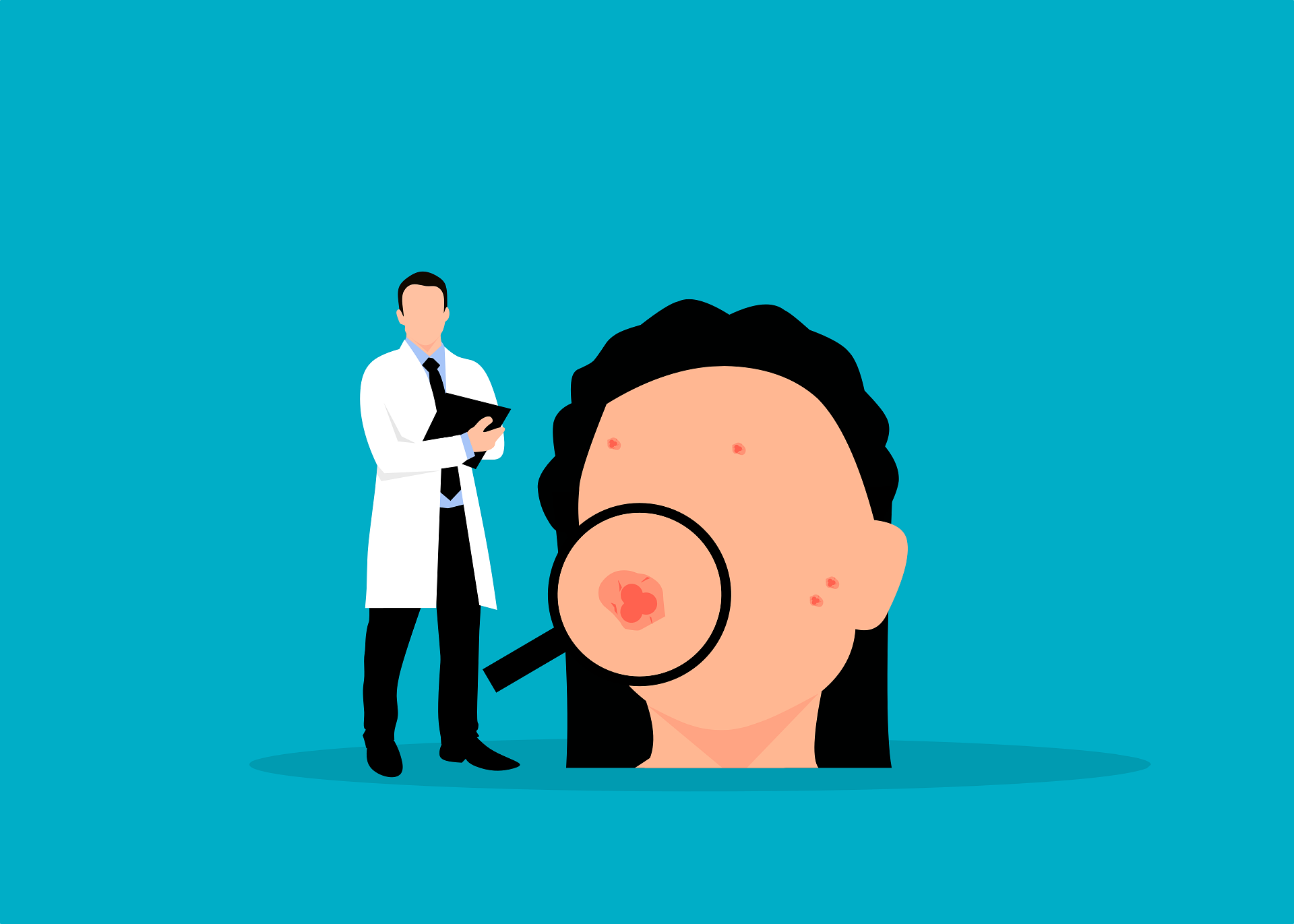
Après 3 mois passés dans le service de dermatologie du Teaching Hospital de Kathmandou, je vous propose de me suivre au cœur de l'action l'instant d'une journée.
L'hospitalisation
Dès 8h30, la journée démarre avec la visite des patients hospitalisés. Ici, pas de chambre individuelle : de grandes salles austères, 6 à 10 lits s'alignent, de fragiles paravents garantissent une intimité minimaliste.
Les constantes du jour, prescriptions et notes d'évolution s'inscrivent à la main dans des dossiers papiers. La visite est brève mais efficace : chaque cas est discuté pour ajuster les traitements et envisager la suite de la prise en charge. Les pathologies relevant d'une hospitalisation varient de l'acné fulminans aux toxidermies, des psoriasis pustuleux ou encore des pemphigus. La famille joue un rôle crucial : elle s'occupe de la toilette et des repas des patients car il n'y a pas d'aides-soignantes. Ce sont les internes de première année qui réalisent eux-mêmes les pansements.
Les consultations
À 9h, direction le « skin OPD (Out Patients Department) » pour les consultations. Une longue file d'attente serpente déjà devant l'entrée. Chaque patient arrive muni d'un « OPD ticket » : un cahier qui fait office de preuve de paiement, de dossier médical et d'ordonnance.
Les salles de consultation, exiguës mais pleines de vie, accueillent jusqu'à trois consultations en parallèle : un médecin sur un coin de table et tout autour les stagiaires, les infirmières, les familles et, bien sûr, les patients. Au fond de la salle, un simple rideau vert dissimule (à peine) une table d'examen où le patient se déshabille si nécessaire. L'interrogatoire est bref, tout comme l'examen. Les internes ont un sens clinique très aiguisé. En cas de difficulté, il est facile d'interroger le sénior qui est juste à côté en train de mener également sa consultation.
Les pathologies les plus fréquentes sont des urticaires, dermatophyties, acné, mélasma mais aussi des cas de lèpre que l'on ne croise presque plus en Europe. Si une biopsie est nécessaire, le patient doit acheter lui-même le matériel avant que l'intervention ne soit planifiée.
Les gestes médicaux
Les internes de première année sont préposés aux « procédures ». Il s'agit d'interventions mineures à visée diagnostique comme les biopsies, les prélèvements mycologiques ou encore la recherche de lèpre dans le suc des patients grâce au SS test (Smear Skin Test).
Ce sont aussi de véritables biologistes ! Dans une petite salle attenante, ils colorent et analysent eux-mêmes les prélèvements au microscope l'après-midi à la recherche de mycobactéries ou du bacille de Hansen.
Certaines interventions thérapeutiques sont également conduites par les internes : injections de corticoïdes intra-lésionnelles (cicatrices chéloïdes, plaques alopéciques), injections du vaccin ROR, applications des podophyllines pour traiter les verrues ou shaving de petites lésions.
Les cours
À 12h30, place aux cours. Préparés par les internes eux-mêmes, ces sessions pédagogiques regroupent des exposés classiques, des présentations de cas cliniques ou des discussions autour de projets de recherche.
Pause déjeuner
Vers 13h, la faim se fait sentir. Direction la cantine pour savourer le traditionnel Dhal Baat Tarkari, une soupe de lentilles servie avec du riz et des légumes que l'on mange avec les mains.
Les gardes
L'après-midi s'enchaîne avec les consultations, tout comme le matin. Elles finissent vers 16h et les internes sont libres excepté un des internes de première année qui est « on duty », c'est-à-dire de garde dans le service. Il assure les avis au sein de l'hôpital, gère les patients hospitalisés et les nouvelles admissions. Il passe la nuit dans la salle de repos sur un canapé. Pas de repos de garde, il faut pouvoir être en forme le lendemain. Cette année, il n'y a que 2 internes de première année : ils dorment donc un jour sur deux à l'hôpital.
Le parcours des études de médecine
Les études de médecine sont assez similaires au système français. Après le lycée, les étudiants passent un concours national déterminant leur université ainsi que l'hôpital associé. Une fois celle-ci intégrée, le parcours repose sur 5 ans de cours théoriques suivis d'un an de stages dans différents services. À l'issue de ces années, les étudiants sont diplômés de médecine générale. Ils doivent exercer un an dans le service de leur choix... S'ils souhaitent choisir une spécialité, ils doivent ensuite passer un nouvel examen national dont le classement leur permettra de choisir leur université ainsi que la spécialité. L'internat de dermatologie dure 3 ans et s'achève avec un examen écrit sur l'ensemble du programme de dermatologie ainsi que le rendu d'une thèse. Il n'y a cependant pas de soutenance orale.
Fun fact
Ici, la coutume veut que l'étudiant offre un stylo à son encadrant pour que celui-ci signe le manuscrit de sa thèse !
Les frais médicaux
L'ensemble des frais médicaux est assuré par les patients. L'accès aux biothérapies est donc très limité notamment dans le cas de la dermatite atopique et le psoriasis dont le traitement des formes réfractaires relève plutôt de la ciclosporine ou du méthotrexate. Les anticorps monoclonaux utilisés sont le rituximab dans le pemphigus et le nivolumab dans le mélanome métastatique. Le seul inhibiteur de JAK est le tofacitinib, prescrit à titre exceptionnel dans le cas de la pelade.
Au cours de mes trois premiers mois, un cas m'a particulièrement bouleversée. Il s'agissait d'un jeune patient de 23 ans présentant un psoriasis pustuleux. Traité à de multiples reprises par des corticostéroïdes oraux, il a développé de nombreuses complications, notamment infectieuses, évoluant vers un choc septique et nécessitant son transfert en unité de soins intensifs. Les hémocultures retrouvaient une entérobactérie multi résistante. Aucun antibiotique n'était disponible pour ce patient. De plus, la famille n'avait pas les moyens de payer pour les traitements. L'hôpital a pu assurer les frais liés aux soins mais ne pouvait pas prendre en charge les traitements. Nous avons tenté d'appeler les industries pharmaceutiques en demandant de donner gracieusement les médicaments… En vain. Cette situation n'est malheureusement pas isolée.
Démunie devant ce cas, je ressens encore fortement le sentiment d'impuissance qui m'a envahi à ce moment. Indéniablement, je réalise l'immense chance que nous avons en France de pouvoir offrir à nos patients l'ensemble des soins nécessaires, quelle que soit leur situation financière.
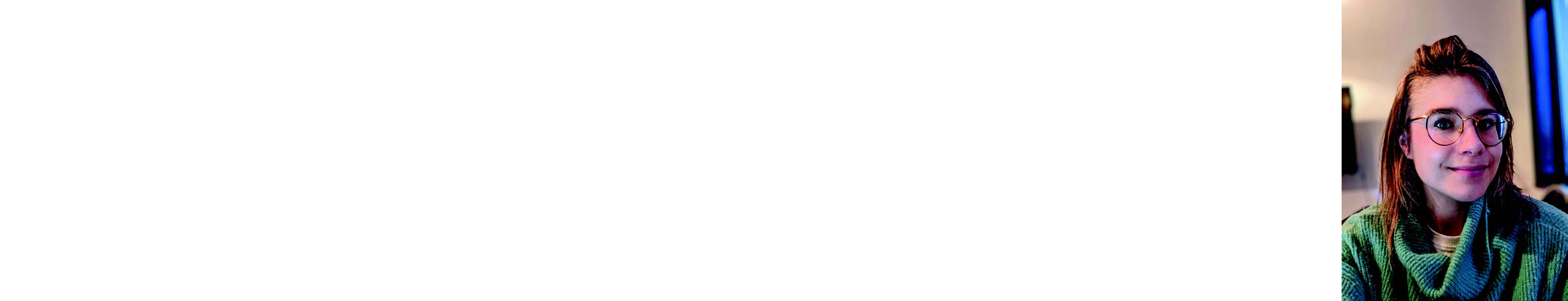
Camille KIEFFER
VP environnement de la FDVF
Interne de dermatologie à Rouen

