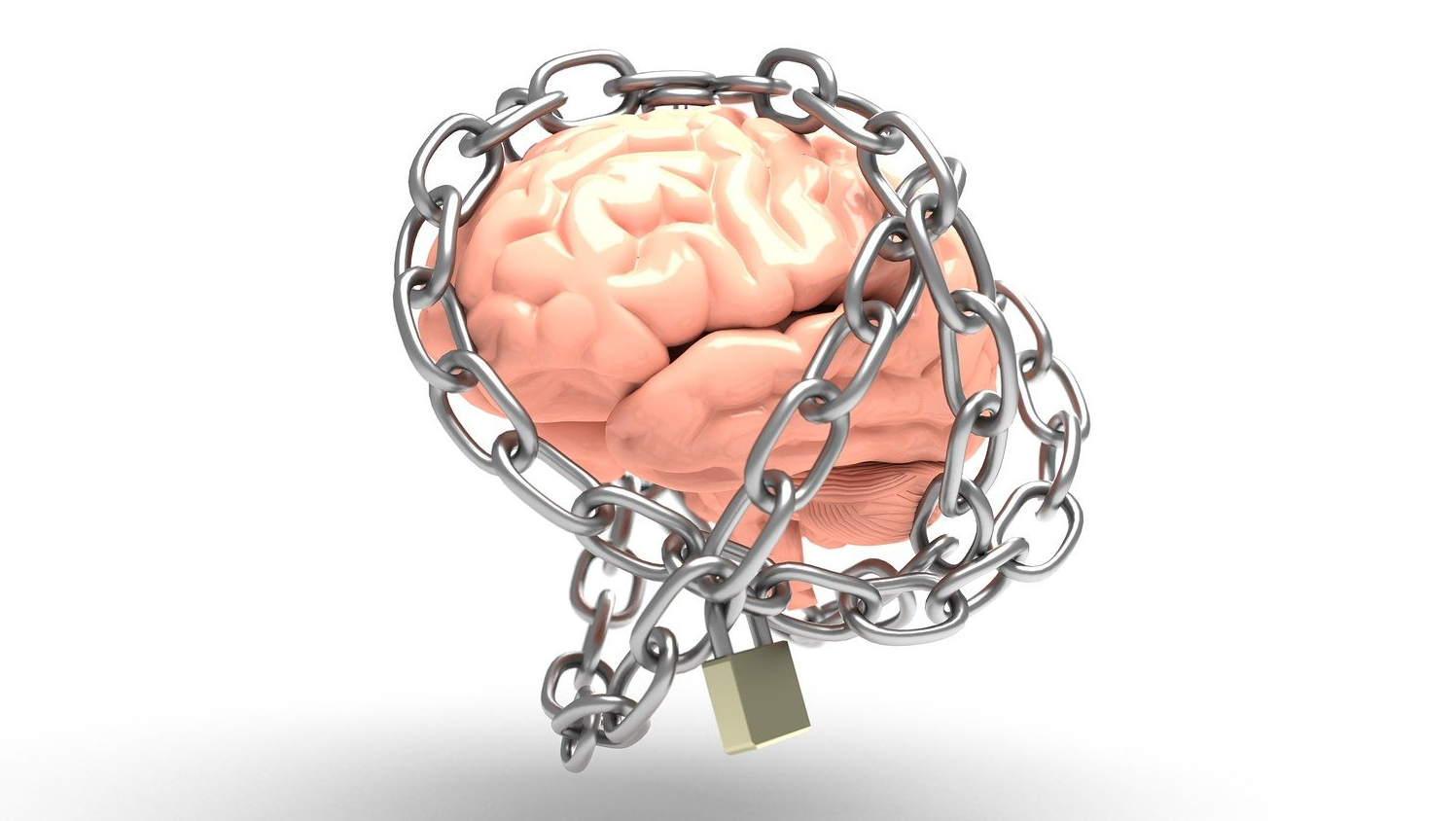
Regards croisés, chemins croisables ?
Michel DAVID
Psychiatre des Hôpitaux
Président de l’ASPMP
Bureau national du SPH, secrétariat à la psychiatrie en milieu pénitentiaire
Communication présentée au 6e colloque soignant de l’EPSAN, Brumath
« Liberté d’aller et venir »
20 et 21 novembre 2014
Comment concevoir passé toute sa vie, et ce dès 22 ans, entre des murs qui vont se rapprocher de plus en plus avec le temps ; l’arbitraire du monde carcéral, les envies suicidaires qui vont se succéder, les fouilles à corps, les coups, les insultes, les frustrations, les humiliations, l’avilissement, les haines qui s’accentuent, les chaines, les mitards, les humeurs des gardiens, leur besoin de se satisfaire sur nous, leur sarcasme, leur provocation, les conflits avec les autres détenus, les mensonges, l’hypocrisie et dissimulation en tout genre, la parano, sa misère et celle des autres, les odeurs, les bruits étouffés, les rires, les pleurs, la folie qui guette, la libido qui fout le camp, la masturbation, la bouffe, les maladies, le morbide, les tentations, les cauchemars, les nuits blanches, les déceptions ; les amitiés balourdes, les trahisons, l’indifférence amplifiée, l’ostracisme, le racisme des matons et des détenus, la peur au ventre, la honte, les envies de chier, le mal de dents, les maux de tête, les cachet, la pète, la déraison, l’abandon, l’oubli de ce qu’on a été, la méchanceté des pauvres, les revanches avortées, les colères, les punitions, l’infantilisation, l’irresponsabilité, l’assistanat, l’enracinement végétal, les balades en fourgon, les menottes, les instructions, le jugement, les bagarres, l’accusation, les idées morbides, les cent mille pas, les regards indiscrets, les illusions d’évasion, le soir, la nuit, la pénombre… L’attente. Combien de sensations ai-je oubliées ?
Joël
PRÉAMBULE
Comme il se doit maintenant avant une communication, il faut faire état d’une situation qui est bien caractéristique de notre époque et qui est souvent pour moi une cause d’irritation. Pourtant, cette obligation ne m’est pas imposée par les organisateurs, et par souci de contradiction ou par névrose, je vais m’y soumettre. Il s’agit de déclarer ces éventuels conflits d’intérêts. Les conflits, le manque de confiance, la transparence sont des obsessions contemporaines. Je vais en fait plutôt déclarer mes « partages » d’intérêt relatifs à la liberté d’aller et venir. Mes engagements associatifs (présidences de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire/ASPMP et de la Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales/Socapsyleg) et syndicaux (membre du bureau national du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux/SPH) en charge du secrétariat à la psychiatrie en milieu pénitentiaire) représentent surtout un intérêt institutionnel à soutenir selon les contextes la liberté d’aller et venir.
Toutefois, il existe quand même des conflits d’intérêts. Exercer la profession de psychiatre est substantiellement en conflit avec la liberté d’aller et venir puisque les psychiatres font partie des rares professions qui ont le pouvoir de priver de liberté une personne. Et le conflit d’intérêts s’aggrave quand en plus le psychiatre exerce en prison…
Une fois, le décor posé, j’en viens à la proposition des organisateurs d’une communication croisant les parcours carcéraux et psychiatriques qui m’a paru être une terrible gageure et le reste. Toutefois, le « hasard » de mon parcours professionnel récent me facilite un peu la tâche. Après dix ans d’exercice en SMPR dans un centre pénitentiaire, j’exerce depuis trois ans dans une unité fermée d’un hôpital psychiatrique accueillant des patients en soins libres ou sans consentement tout en poursuivant une activité de consultation en maison d’arrêt.
Je suis donc exposé à une confrontation permanente entre les privations de liberté carcérales et psychiatriques ; à l’intervention des juges dans les deux situations et parfois le même : le JLD. ; aux rôles des avocats et à tous les épiphénomènes qui les accompagnent (dont le financement) ; aux espoirs d’une liberté à retrouver comme les déceptions quand la décision du juge que le patient considérait comme le garant des libertés ne devient que celle de celui qui confirme une « détention » même si elle n’est que psychiatrique ; aux arbitraires des protocoles sécuriphiles à l’appétence démesurée pour un pointillisme exaspérant ; à la relation à la temporalité très différente entre prison et hôpital ; à une relation à l’espace parfois similaire parfois très différente et pas dans le sens qu’on pourrait le croire de prime abord ; à l’encadrement des relations familiales ; à la « clinique » du discernement et aux pièges de l’appréciation du consentement (rarement libre et éclairé) ; aux représentations différentes que nous avons tous de la liberté, des contraintes notamment celles que nous impose la liberté d’écrire : certificats, attestations et à l’absence de confidentialité et à l’abrasion progressive du secret professionnel.
Mais avant d’évoquer quelques-uns parmi ces points, je vais vous relater une situation clinique, que certains d’entre vous connaissent peut-être, et qui n’est à l’honneur ni de la psychiatrie ni des exigences éthiques de notre société. Cette dramatique situation - il y a au moins un mort - est assez exemplaire des chemins croisables entre prison et hôpital psychiatrique, tout en posant la question des droits de l’homme telle qu’elle est posée dans l’argumentaire des présentes journées et surtout du décalage entre les droits théoriques et leurs applications.
À minuit passé tes gémissements m’ont réveillé. Dans la pénombre de la cellule, aux murs de laquelle se projetait l’ombre des barreaux et du grillage, tu as fini par m’appeler au secours dans un râle faiblissant. Encore comateux de mon sommeil interrompu, je me suis levé et ai allumé pour découvrir avec horreur le carnage. Au travers du matelas de mousse, ton sang avait fini par filtrer et me couler dessus. Par réflexe, plus que par ressentiment, je t’ai engueulé, traité d’abruti parce que tu avais choisi la façon la plus lâche de mourir
Collectif Poissy, Le mode, 22 janvier 2000
L’histoire de monsieur G18
Ou comment être dépossédé de la liberté d’aller et venir
Quand le chemin de croix carcéral de monsieur G va commencer, et qui va durer de mai 2005 à septembre 2009, il est âgé de 31 ans, mais son parcours est déjà difficile depuis l’âge de 22 ans où ses hospitalisations en psychiatrie ont débuté pour hallucinations, propos délirants, conduites agressives et abus de toxiques et vie de SDF. Un diagnostic de schizophrénie est le plus souvent avancé.
En mai 2005, il se présente aux urgences de l’hôpital psychiatrique d’une grande ville en souhaitant être hospitalisé. Apparemment, sa démarche n’est pas accueillie comme il le souhaiterait et il se livre à des dégradations qui le conduisent non pas à l’hôpital, mais à la prison et pour lesquelles il sera condamné à douze mois d’emprisonnement, dont dix avec sursis. 1er épisode de ces chemins croisables. Dès son placement au quartier « arrivant », il met le feu à son matelas et il « récidive » (ou rechute) trois mois après en mettant le feu de nouveau dans sa cellule. Son codétenu brûlé à 65 % mourra six mois plus tard. Il sera mis en examen d’abord pour destruction de biens ayant entraîné une ITT>8 j puis le chef d’inculpation sera aggravé, car les faits ont entrainé la mort. Interrogé sur les raisons de l’incendie, monsieur G avait déclaré qu’il « ne se souvenait pas dans quelles circonstances précises son matelas avait pris feu », qu’il « souffrait de schizophrénie, entendait des voix et voyait des choses bizarres, mais que, à présent, tout allait mieux » et déclara « je suis plus libre depuis qu’il y a eu le feu dans ma cellule, car tout est plus clair dans ma tête. Je peux dire que maintenant tout est calme ». Apaisement récent des patients psychotiques après un passage à l’acte. C’est tellement calme dans sa tête qu’il a rapidement été placé au SMPR. Il va alterner ensuite d’incessants passages entre hospitalisations en milieu psychiatrique ou placement au SMPR avec finalement de très rares moments en détention ordinaire, non adaptée à sa situation. Je ne vais pas vous lasser en égrainant ces allées et venues aussi inutiles que non thérapeutiques.
Que disent donc les experts psychiatres sollicités à diverses reprises. En janvier 2006, le Dr F. diagnostique « une personnalité schizoïde avec une attitude de repli et de désintérêt pour le monde extérieur. Il a besoin d’un suivi psychiatrique durable et soutenu. Pendant l’incarcération, il est préférable qu’il soit hospitalisé dans une unité de soins comme le SMPR où il est actuellement ». Deux autres expertises réalisées en février et juin 2006 concluent à une psychose schizophrénique de type héboïdophrénique. L’une d’entre elles retient un discernement altéré au moment des faits, un sujet peu curable ou réadaptable, la nécessité de donner un traitement neuroleptique à fortes doses avec un suivi régulier voire en UMD. La deuxième refuse de faire un lien entre les faits et les troubles psychiques et ne se prononce ni pour l’altération ni pour l’abolition du discernement. Toutefois, monsieur G doit faire l’objet, y compris après sa libération, d’une prise en charge spécialisée.
Heureusement, l’avocat du prévenu est présent pour le soutenir, argumente l’inaccessibilité à la sanction pénale et demande une libération provisoire qui est refusée, car la détention met fin au trouble à l’ordre public (dont il faut noter que sa plus forte expression a été un incendie en détention avec mort d’homme…).
Fin 2007, un événement intéressant survient. Un surveillant sera condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour une gifle donnée à monsieur G qui avait refusé d’être placé dans une cellule où une personne détenue avait mis le feu et ou une autre était suicidaire…
Fin 2008, devant comparaître devant la cour d’assises, la présidente demande une expertise pour apprécier son aptitude à comparaître. L’expert note que : « Depuis qu’il est incarcéré pour la présente affaire, il a apparemment bénéficié de cinq séjours psychiatriques, en hospitalisation d’office, par rapport à des moments de décompression anxio-délirante à thème notamment persécutoire, et pour des séjours de décompression par rapport aux nombreux séjours qu’il a déjà effectués au SMPR. Il bénéficie du traitement suivant : Zyprexa 20mg, Tercian 370 gouttes, Rivotril 30 gouttes x 4, Lepticur x 1, Havlane x 1 (traitement antipsychotique atypique, anxiolytique sédatif, hypnotique, correcteur). Lors de l’examen, il s’est montré conscient, malgré l’importance de ses troubles, du fait qu’il allait prochainement comparaître devant une cour d’assises, et m’est apparu, compte tenu de sa pathologie, pouvoir s’exprimer à ce sujet.
Certes, son traitement est essentiellement à visée thérapeutique par rapport aux troubles qu’il présente, mais a des effets également sur ses capacités de fonctionnement psychique avec un certain degré de ralentissement, mais le jour de mon examen, il m’est apparu ne pas être confus, désorienté, et ne pas être actuellement en phase aigüe par rapport à la maladie chronique qu’il présente. De fait son état m’est apparu actuellement compatible avec sa comparution à l’audience ». Évidemment lors de la comparution aux Assises, 4 jours après cet examen, monsieur G se montre prostré dans l’incapacité de répondre aux questions… Il sera néanmoins reconnu responsable de ses actes et condamné à 10 ans de réclusion criminelle et reconduit au SMPR. De nouvelles hospitalisations en psychiatrie suivront.
Son avocat fera appel et fait état des articles 3 (traitement inhumain et dégradant) et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention des droits de l’Homme19. De nouvelles expertises seront demandées. Un expert de la première heure qui ne s’était pas prononcé pour l’abolition finira par s’y ranger et à la suite du procès en appel de la cour d’assises en septembre 2009, monsieur G sera reconnu irresponsable et immédiatement hospitalisé en psychiatrie. La France sera finalement condamnée pour l’article 3, mais pas pour l’article 6.
Je pourrai m’arrêter là, vous suggérant de lire cet intéressant arrêt récent pris le 23 février 2012 par la Cour Européenne des droits de l’homme en cette bonne ville de Strasbourg, mais je vous lis encore un passage qui illustre bien notre sujet : « En premier lieu, la Cour est frappée par la répétition et la fréquence des hospitalisations de l’intéressé. Les nombreuses périodes de soins délivrés à la fois hors du milieu carcéral dans le cadre des hospitalisations d’office et au sein du SMPR soulignaient le caractère grave et chronique des troubles mentaux du requérant. Les décisions d’hospitalisations dans un établissement de santé prises à l’égard du requérant conformément à l’article D. 398 du code de procédure pénale en 2007, 2008 et 2009 étaient ordonnées chaque fois que son état de santé n’était plus compatible avec la détention. Il retournait ensuite soit au sein du SMPR de la prison soit en cellule ordinaire jusqu’à ce que son état se dégrade à nouveau. Dans ces conditions, il était vain d’alterner les séjours à l’hôpital psychiatrique et en prison, les premiers étant trop brefs et aléatoires, les seconds incompréhensibles et angoissants pour le requérant, dangereux pour lui-même et autrui. La cour observe ainsi que l’alternance des soins, en prison et dans un établissement spécialisé, et de l’incarcération faisait manifestement obstacle à la stabilisation de l’état de l’intéressé, démontrant ainsi son incapacité à la détention au regard de l’article 3 de la Convention ».
Il est possible de relier cette histoire au procès récent de Stéphane Moitoiret et Noëlla Hégo bien relaté par le journaliste Jean-Charles Marchand dans un livre consacré à ce sujet qui illustre le refus ou la réticence de reconnaître la maladie mentale, ou tout du moins à refuser l’irresponsabilité pénale20.
Ces situations conduisent certains auteurs à se demander : « Qui est irresponsable ? »21 et à constater la grave crise de l’expertise psychiatrique pénale22.
- http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109218#{% 22 itemid%22:[%22001-109218%22]}
- http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
- Marchand J., Valentin et les délirants, Monographie d’un délire à deux meurtrier, Editions Anne Carrière, Paris 2014.
- Rossinelli DG, Penochet JC. Qui est irresponsable ? L’Information psychiatrique 2014 ; 90 : 173-6 doi : 10.1684/ipe.2014.1173
- Zagury D, Senon JL. L’expertise psychiatrique pénale en France, un système à la dérive. L’information psychiatrique 2014 ; 90 : 627-9 doi : 10.1684/ipe.2014.1246
Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Tableau 1. Article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme
Droit à un procès équitable
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
- Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
- Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
Tableau 2. Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
En prison, on prend conscience de soi-même, on apprend à se connaître ; on fait sur soi d’étonnantes découvertes. Et quel réconfort si l’on peut se trouver un cœur ferme : Telles sont les fortes nourritures de la solitude.
Jean Zay, Souvenirs et solitudes
Parentés des privations de libertés carcérales et psychiatriques
Le principe organisé et théorisé de la privation de liberté est né au début du XIXe siècle, dans les droites lignes de la liberté acquise du citoyen désassujetti du pouvoir royal aussi bien pour la psychiatrie que pour la prison. Et même si les finalités sont différentes, thérapeutique pour la psychiatrie et punissable pour la prison, une finalité est toutefois commune : la protection de l’ordre publique, clairement formulée dès la loi de 1838 pour décider d’une hospitalisation d’office pour la psychiatrie. La sanction pénale à la même époque insistait sur le principe de l’amendement d’où la pénitence et l’administration qui se qualifie autour de ce principe dès sa création en 1795. Dans cette période de créations, prison et psychiatrie relevaient du ministère de l’Intérieur et s’allient parallèlement autour de l’ordre public. Ce n’est qu’en 1911 que l’AP est rattachée au ministère de la Justice et hasard de l’histoire, la psychiatrie sort partiellement de la « surveillance » du ministère de l’Intérieur, par l’entremise du préfet que 100 ans plus tard avec la loi du 5 juillet 2011.
À cette date s’ouvre une nouvelle ère sur la prise de décision de privation de liberté en psychiatrie avec différents décideurs qui y concourent. Cette question est d’ailleurs loin d’être close et a fait partie des interrogations du député Denys Robiliard au cours de sa mission parlementaire sur « La santé mentale et l’avenir de la psychiatrie ». Actuellement, pour les soins sur demande d’un tiers, le médecin propose, le directeur de l’établissement de santé prononce l’admission ; pour les soins sur décision du représentant de l’État, le médecin propose, le préfet décide, le directeur admet. Dans les deux cas, au bout de 12 jours, le JLD confirme l’hospitalisation ou en prononce la levée. Le débat sur le décideur est loin d’être clos. Évidemment, pour la prison, le juge décide, mais l’avis psychiatrique peut ne pas être négligeable sans oublier les situations où le magistrat « prescrit » la psychiatrie (incarcération, mais orientation sur le SMPR).
Pour compléter le parallèle entre les origines de la prison et la psychiatrie, on peut relever une composante « psychologique ». La prison du début du XIXe siècle s’intéressait à l’amendement, au retour sur soi auquel le condamné pouvait s’adonner dans la solitude carcérale, comme le rappelait encore tout récemment (28 octobre 2014) le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale lors du débat sur l’encellulement individuel23 : « Le but était que l’isolement permette l’introspection, seul chemin vers la rédemption » tout en faisant remarquer « que l’encellulement individuel relève davantage maintenant de la dignité humaine ». Toutefois, le principe de l’amendement, où la personne incarcérée se trouvait seule avec sa conscience pour analyser ses actes se trouve remplacée par la confession psychiatrique et toutes formes d’obligations/injonctions/programmes de soins.
Un humoriste a proposé d’inscrire dans le stage des magistrats quinze jours de détention, afin qu’ils sachent ce que représentent exactement les peines qu’ils infligeront dans leur carrière. Comment le sauraient-ils, même à ce prix ? Pour doser sciemment un châtiment, comme pour apprécier une culpabilité, il faudrait avoir vécu toute l’existence de l’homme, connaître tous ses ressorts physiques et moraux. Rendre la justice est la plus insensée de toutes les entreprises humaines.
Jean Zay, Souvenirs et solitude
- http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150037.asp
Psychiatrie et Justice : comment se partager les juges et les avocats ?
Leur rôle sur les limitations d’allers et venir
Il est d’usage d’insister sur la fonction créatrice de son identité que la justice a exercée sur la psychiatrie. Les grands procès (Papavoine, Léger, Rivière) du XIXe siècle ont permis à de célèbres aliénistes d’affiner la clinique psychiatrique autour du concept de démence avancé à l’article 64 du Code pénal de 1810. Les aliénistes puis les psychiatres ont ainsi côtoyé les magistrats principalement les juges d’instruction autour de leurs missions expertales qui sont restées longtemps prestigieuses contrairement à l’époque contemporaine malgré le paradoxe de la multiplication des demandes d’avis expertal.
L’étape suivante d’une augmentation des occurrences de fréquentation professionnelle de la psychiatrie et de la justice eut lieu avec le code de procédure pénale de 1958 et la création du sursis avec mise à l’épreuve (SME) accompagné d’obligations de soin qui pouvaient être prononcées et ordonnées sous l’étrange formule suivante « le condamné a l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ». Étonnant la notion de soumission pour un soin, notamment en considération de la loi Kouchner de 2002 qui a mis l’usager comme décisionnaire des modalités des soins qu’il doit recevoir.
La relation plutôt rejetante de la psychiatrie avec l’obligation de soins, est peut-être due au fait que les psychiatres ont parfois l’impression que la Justice voudrait que ce soit eux qui se soumettent à la décision judiciaire. Cette étape toujours d’actualité avec des méfiances partagées entre psychiatres et juges et plus particulièrement les JAP connaîtra peut-être un nouvel essor avec la contrainte pénale.
Ce n’est vraiment qu’en 2011 qu’un réel partage d’activités professionnelles s’instaure entre juges et psychiatres, bien que chargé d’ambiguïtés. Juge des libertés et de la détention et avocats font le pont entre l’hôpital psychiatrique et la prison. Indéniablement un message de pénalisation du soin est lancé par la société aux usagers de la psychiatrie. Non seulement privés de liberté, les patients se voient imposer un juge dont, pour éviter de les effrayer, les soignants peuvent le présenter comme le juge des libertés en omettant pudiquement la référence à la détention, ouvrant ainsi à une déception ultérieure quand le juge confirme l’hospitalisation, des audiences dans les tribunaux, un avocat (qu’ils doivent rémunérer sans l’avoir demandé), des formulaires incompréhensibles pour notification des décisions et respect formel de leurs droits. Les patients ne s’y trompent pas : « Quelle faute ai-je donc commise ? Pourquoi me punir en me cantonnant à l’hôpital ? Que dois-je prouver pour sortir d’ici ? Pourquoi je dois voir un juge, un avocat ? » Il s’agit d’une vraie question « éthique », très débattue à l’instauration de la loi et qui se noie maintenant dans le tourbillon de la quotidienneté et de la routine. Et puis, qui cela intéresse-t-il ?
Perpétuité ? Un tunnel sans fin, dans lequel on finit par ne plus espérer voir au loin une lueur de sortie. Car il n’y a pas de limite dans le temps. C’est une chute interminable dont on perçoit à peine les différentes étapes qui produisent notre minutieuse destruction. La mort à petit feu, qui commence par la perte de toutes notions, affectives, familiales, sociales, si on ne parvient pas à entretenir un lien avec l’extérieur.
Laurent, Arles
J’ai appris le verbe attendre. Je le connais profondément, il m’a accompagné, harcelée. J’ai passé mes journées à attendre, attendre que la porte s’ouvre, attendre que quelqu’un décide pour moi, le juge, l’avocat, la prof de sport, la gardienne.
Sylvaine
Temporalité carcérale / temporalité psychiatrique
La peine de prison est définie, dès que prononcée, autour d’une durée, avec même maintenant les crédits de réduction de peine fixés dès le jugement. Aussi, la date maximale où surviendra la libération est connue rapidement. Des ajustements sont possibles en fonction des remises de peine supplémentaires ou de l’octroi d’une libération conditionnelle, mais dans l’ensemble un balisage temporel existe.
Pour la psychiatrie, aucune limite ne peut être fixée d’emblée. Pour les patients hospitalisés ou non en UMD après un non-lieu pour motif psychiatrique, la situation est encore plus douloureusement incertaine et désespérante. Dans tous les cas, souvent un temps suspendu, répétitif, souvent oisif d’une monotonie déprimante. À ce temps au déroulement ritualisé répondent des espaces aussi peu réjouissants.
Je suis enfermé dans une cellule. Un œil-de-bœuf inaccessible laisse pénétrer un peu de lumière ; le plafond est haut ; un bat-flanc à charnière est collé contre la paroi de ce caveau. C’est tout. C’est le cadre qui convient au banni de la société ; au prisonnier.
Raymond, Tournai
Espace carcéral / espace psychiatrique : cellules vs chambres ?
L’espace carcéral, on le sait, se caractérise actuellement par une surpopulation importante, principalement en maison d’arrêt. Pour donner un exemple, celle où je travaille actuellement a un effectif théorique de 40 personnes pour un effectif réel d’environ 80 personnes réparties dans 11 cellules. Oui, 11 cellules… La question de l’encellulement individuel est d’ailleurs très actuelle du fait de l’échéance du moratoire l’imposant au 25 novembre prochain24.
Terme monacal pour la prison dans la droite ligne de la pénitence. Et quand il faut réprimer et isoler, le mitard, le QD, quartier disciplinaire est requis. Plus récemment, dans la novlangue pénitentiaire est apparue la « CproU » : la cellule de protection d’urgence, sorte de préservatif non pas utilisé dans un moment de plaisir, mais pour se protéger du risque suicidaire. La CproU est parfois aussi appelée « cellule lisse ». Comme l’adjectif le dit bien, elle ne présente aucune aspérité facilitant les tentatives de pendaison, mais aussi aucune aspérité pour se raccrocher à la vie.
En psychiatrie, les chambres équipent les services, mais les plus anciens de l’hôpital où je travaille se souviennent que l’on parlait de cellules il y a seulement 30/40 ans. Les chambres des hôpitaux psychiatriques sont plus ou moins accueillantes et confortables, sans systématiquement « d’enchambrement individuel », mais il existe des chambres d’isolement ou de sécurité (CSI), voire encore parfois capitonnées. Et l’on se rapproche du mitard. Les personnes détenues qui doivent être hospitalisées, les connaissent bien au point qu’appréciant leur inhospitalier confort, elles demandent un retour rapide en prison… Triste image de la psychiatrie.
Et dans ces espaces psychiatriques confinés, le temps d’isolement est bien imprécis bien qu’un contrôle médical régulier doit en assurer le début et la fin. D’où le souhait du CGLPL d’un registre non inclus dans le dossier médical qui permettrait d’avoir une traçabilité des mesures d’isolement alors que le mitard carcéral est bien plus traçable avec une durée maximale qui a été réduite de 45 j à 30 j avec la loi pénitentiaire de 2009 (Tableau 3) et la mise à l’isolement limitée à trois mois (Tableau 4).
Et les croisements et similitudes entre isolement carcéral et psychiatrique pour des raisons punitives ne sont pas des raretés comme il est rappelé dans le rapport du CGLPL en 2012 dans un chapitre intitulé : « Des pratiques thérapeutiques détournées à des fins disciplinaires dans les établissements de santé »25. L’exemple suivant y est notamment donné : « Dans un établissement situé Outre-Mer, le personnel soignant a très clairement affirmé que la chambre d’isolement faisait fonction de “cellule de punition” pour sanctionner certains patients. Telle était d’ailleurs la situation d’un malade qui bénéficiait d’une irresponsabilité pénale sur le fondement de l’article 122-1 du Code pénal et qui avait été placé à l’isolement depuis quinze jours “pour avoir eu une relation sexuelle avec une patiente et l’empêcher de recommencer à nouveau”. Dans cet établissement, le placement en chambre d’isolement pour des raisons thérapeutiques n’a jamais été avancé par les soignants rencontrés »26.
La mission de l’Assemblée nationale sur « La santé mentale et l’avenir de la psychiatrie » dont le député Denys Robiliard était le rapporteur a aussi relevé la problématique des recours à l’isolement et à la contention. Lors son audition auprès de la mission d’information, le président du SPH, Jean-Claude Pénochet, interrogé sur l’augmentation du recours à la contention en psychiatrie disait sans langue de bois que « La contention est un indicateur de la bonne ou de la mauvaise santé de la psychiatrie. Plus la psychiatrie va mal, plus la contention est utilisée »27. Question qui interpelle bien entendu directement et en premier la psychiatrie, mais qu’on ne peut isoler des préoccupations sécuritaires de la société et de ses limites financières.
- Rapport d’information sur l’encellulement individuel, Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2388.asp
- Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Rapport d’activité 2012. Dalloz.
- Ibid. 117-118.
- Assemblée nationale. Rapport d’information n° 1162. Santé mentale : quand la démocratie soigne. Commission des affaires sociales. Président : Jean-Pierre Barbier. Rapporteur : Denys Robiliard. Décembre 2013. Documents d’information. www.assemblee-nationale.fr.
Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes.
Tableau 3. Article 726 du Code de procédure pénale : Isolement disciplinaire
Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire.
Tableau 4. Article 726-1 du code de procédure pénale : Isolement pénitentiaire
Ma Chérie hors temps.
J’ai aimé ta façon de m’embrasser, de tes baisers ralentis plus qu’aimés. J’en suis encore bouleversé… et ce regard long que tu as plongé en moi… Tout ce que tes yeux ont à me donner de toi, je m’en emplirai des heures et des heures, m’en rechargerai…Vivrai dans notre monde, notre vie avec toi…. Pour être sûr que je ne rêve pas, j’aurai la réalité de mes lèvres à portée des tiennes, des baisers frôlés, partagés, ralentis et lents pour vivre ton existence…
Roger Knobelspiess, Lettres de prison
Vie sexuelle carcérale et psychiatrique « bridée » : questions de dignité
Un collègue-chef d’un SMPR me confiait récemment avoir rendu visite à un proche incarcéré. Étant pour une fois du côté des familles en visite, son malaise a été grand d’être exposé aux relations intimes d’un couple près de lui, conduites amoureuses pourtant interdites, mais qui selon les moments, les personnes, les lieux sont parfois tolérées. Paradoxe d’une sexualité qui est censée de pas s’exprimer en prison bien que dans le kit d’hygiène remis à la personne entrante, des préservatifs y soient inclus, sans oublier la TV qui ne censure pas les films pornographiques à l’effet thérapeutique « apaisant » et d’exemplarité dans le respect de la relation à autrui, notamment pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. Et la misère sexuelle s’ajoutant aux misères sociales se complait d’une homosexualité contrainte, honteuse, par défaut….
La similitude des régimes disciplinaires des hôpitaux psychiatriques et des prisons conduit à des questionnements identiques sur la vie sexuelle en hôpital psychiatrique. Ainsi la cour administrative d’appel de Bordeaux28 a considéré en 2012 que le règlement intérieur d’une unité fonctionnelle du centre hospitalier de Cadillac qui stipulait que dans l’unité « Les relations de nature sexuelle ne sont pas autorisées » était illégal, car reposant sur une disposition générale et non individualisée (Tableau 5).
Considérant, toutefois, que l’interdiction en cause, qui s’impose à tous les patients de l’unité, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présente un caractère général et absolu ; que le centre hospitalier n’invoque aucun élément précis relatif à l’état de santé des patients de cette unité et à la mise en œuvre de traitements médicaux qui justifierait une interdiction d’une telle portée ; que, telle que formulée dans le règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil, l’interdiction en cause impose à l’ensemble des patients de cette unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ; que la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a refusé d’abroger la disposition litigieuse du règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil est donc entachée d’illégalité.
Tableau 5. Cour administrative d’appel de Bordeaux et la sexualité en EPSM
La justice est le grain de beauté de la haine. Ce grain a été tracé, maquillé par la main de l’homme de pouvoir. Même ici où, normalement on devrait redresser l’homme, c’est le contraire. Rien ne va avec la vie de l’homme de conscience. Tout est administré, c’est-à-dire imposé, et cela tue la responsabilité de l’individu. C’est là le négatif de la prison.
Michel
- http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026654357
Obligations, injonctions, programmes de soin Entre peine, mesures de sûreté et « thérapeutiques » : une liberté très encadrée et bien ambigüe
Une forme particulière de restriction des libertés s’exprime dans un ensemble de mesures qui représente une « contrainte » présumée librement consentie. Il s’agit de l’obligation de soin (OS) depuis 1958 accompagnant le plus souvent un sursis avec mise à l’épreuve, l’injonction de soin (IS) depuis 1998 et le programme de soin (PS) depuis 2011.
Dans tous ces cas, une communauté d’acteurs : la personne intéressée, le juge, le psychiatre et l’avocat. Dans tous les cas également, le consentement est censé acquis par la personne concernée, mais sa liberté de décision, en l’occurrence sa capacité à consentir de manière libre et éclairée, selon la formule juridique consacrée, est très étroite. Le non-respect de l’OS peut conduire à la révocation du sursis ; dans l’IS, une peine de réincarcération est fixée dès le jugement si la mesure n’est pas respectée ; dans le PS, qui parfois selon la formule type utilisée par le JLD, doit être établi le cas échéant dans les 24 heures, après que « l’avis du patient ait été recueilli préalablement à la définition du PS et avant toute modification de celui-ci » un certificat médical circonstancié peut reconduire le patient en hospitalisation complète et une jurisprudence abondante n’en finit pas d’en compliquer la règle29.
Les débats agitent les juristes pour qualifier les OS et les IS de peines ou de mesures de sûreté. Elles sont certainement un peu des deux. Quant au PS qui est censé n’être que purement thérapeutique, il n’est pas aussi clairement perçu par les patients, sans compter que notre profession en détourne parfois l’usage pour l’utiliser comme une réelle mesure de sûreté, par exemple en élaborant des programmes de soins comportant en fait des hospitalisations complètes avec un minimum de sorties à l’extérieur de l’hôpital.
Le juge étant constitutionnellement le garant de la liberté individuelle (Tableau 6), il intervient dans ces situations, sauf pour le PS où l’arbitraire psychiatrique peut s’engouffrer en dehors de tout contrôle judiciaire. Ces mesures sont soumises au regard des magistrats et représentent une restriction forte à la liberté d'aller et venir des intéressés sans compter le détournement hypocrite du consentement libre de toute contrainte censé être acquis.
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Tableau 6. Article 66 de la Constitution
Le Docteur P vient me voir une fois par semaine. Je lui ai demandé de m’envoyer en psychiatrie, un endroit où l’on puisse vraiment m’aider à résoudre mes problèmes, alors qu’ici j’ai le sentiment de ne faire que perdre mon temps. Le psy me donne de plus en plus de cachets pour dormir et être ensuqué. Je ne sais pas combien cela fait de temps que je suis là, sûrement pas encore la moitié.
Sébastien
- Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du mercredi 15 octobre 2014, N° de pourvoi: 13-12220 Publié au bulletin Cassation
La suspension de peine pour raison psychiatrique : La liberté psychiatrique retrouvée ?
Avec l’affaire G. c. France, psychiatres, administration pénitentiaire, justice, préfet se sont donné la possibilité de faire aller et venir à leur guise monsieur G en d’incessants allers et retours entre prison et hôpital, sans possibilité apparente de stopper cet infernal système, qu’il soit prévenu ou condamné tant qu’un non-lieu n’a pas été rendu et qui a conduit à fixer au moins temporairement et sans limitation de durée l’intéressé à l’hôpital psychiatrique. Depuis la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, la suspension de peine pour raison psychiatrique a connu une certaine clarification.
Rappelons qu’en 2002, la loi dite Kouchner instaure la suspension de peine pour raison médicale en cas de pronostic vital engagé ou d’état de santé durablement incompatible avec la détention « hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux », créant ainsi un régime différencié entre pathologies somatiques et psychiatriques (Tableau 7). De 2002 jusqu’à ce jour, il y eut un consensus informel, sorte de scotome collectif, pour admettre que la suspension de peine pour raison psychiatrique n’était pas possible. L’alternative pour un malade mental délinquant ne pouvait être que la prison ou l’hôpital psychiatrique en hospitalisation d’office.
Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
Tableau 7. La suspension de peine pour raison médicale de 2002 à 2014
Article 720-1-1 ancien du code de procédure pénale
En décembre 2012, les ministres de la Santé et de la Justice en visite au centre pénitentiaire de Fresnes annoncent le lancement de deux groupes de travail, un sur la suspension de peine pour en améliorer l’effectivité et en voir l’application pour les maladies mentales ; l’autre sur la limitation des risques infectieux en prison (p. ex. programme d’échanges de seringues). Les travaux du groupe de travail sur la suspension de peine font apparaître que celle-ci était possible pour raison psychiatrique, mais uniquement quand la personne n’était pas hospitalisée en psychiatrie. Grosse surprise. Et le groupe de travail demande la suppression de la phrase litigieuse afin de lever toute ambiguïté.
La loi du 15 août 2014 a apporté quelques améliorations, en fait une timide avancée. Concernant l’état de santé, il est précisé qu’il peut être aussi bien physique que mental. Malheureusement, il existe toujours une restriction pour les personnes hospitalisées sans leur consentement, seule l’hospitalisation libre en UHSA permet la demande de suspension de peine (Tableau 8).
Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension ne peut être ordonnée en application du présent article pour les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement.
Tableau 8. La suspension de peine pour raison médicale à partir du 15/08/2014
Article 720-1-1 nouveau du code de procédure pénale
À noter aussi que la loi introduit « à tous les stades de la procédure », donc y compris la possibilité pour les personnes prévenues d’une mise en liberté pour les mêmes raisons que pour les personnes condamnées (Tableau 9).
En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. La mise en liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peut être ordonnée en application du présent article. « En cas d’urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin. « La décision de mise en liberté peut être assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. « L’évolution de l’état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l’article 144 sont réunies.
Tableau 9. La mise en liberté pour les personnes prévenues pour raison médicale
Article 147-1 du code de procédure pénale
Enfin, la loi soulève un point qui a pu être à l’origine de la réticence des psychiatres exerçant en milieu pénitentiaire à demander une suspension de peine et qui permet une facilitation de l’accès à la libération conditionnelle même si le temps nécessaire pour y avoir droit n’est pas atteint lorsque la personne a bénéficié de la suspension de peine depuis au moins trois ans et pour laquelle une expertise confirme l’incompatibilité durable avec la détention. (Tableau 10).
Lorsque le condamné bénéficie d’une mesure de suspension de peine sur le fondement de l’article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l’issue d’un délai de trois ans après l’octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation.
Tableau 10. Facilitation de l’accès à la libération conditionnelle
Il reste maintenant à voir si les psychiatres exerçant en prison face à une situation comme celle de monsieur G. vont demander une suspension de peine et à observer les réactions des équipes de secteur et des administratifs hospitaliers face à l’arrivée de ces nouveaux patients, considérés en général persona non grata dans leurs services.
Le choix, pour le médecin individuel, est entre appliquer sans concession les exigences issues du serment d’Hippocrate, au risque d’être éliminé du milieu carcéral, et consentir aux contraintes constitutives de ce milieu le minimum d’exceptions compatibles avec le respect de soi, le respect d’autrui et celui de la règle.
Ricoeur P., Soi-même comme un autre
Confidentialité et secret professionnel : la primauté des obsessions sécuritaires
Il s’agit d’un thème qui me tient particulièrement à cœur. Souvent, je constate qu’en prison se dessinent des évolutions sociétales qui préfigurent celles qui sortiront de l’univers carcéral pour se répandre dans la société. L’abrasion progressive du secret médical est probablement un des exemples les plus significatifs. Sans pouvoir détailler ce sujet qui pourrait alimenter à lui seul plusieurs congrès, il est aisé de donner quelques repères significatifs. Inutile d’insister sur l’absence d’intimité et de confidentialité de la prison, qu’elle soit surpeuplée ou non, le regard posé sur la personne détenue est consubstantiel de l’univers carcéral. Des textes relativement récents (2010) suggèrent fortement aux personnels soignants de participer aux CPU, les commissions pluridisciplinaires uniques, qui ont pour objet d’étudier le parcours d’exécution des peines des personnes condamnées. L’échange d’informations opérationnelles souhaitées par les pouvoirs publics met les soignants s’ils acceptent de participer aux CPU dans des positions très délicates par rapport à leurs patients. En outre, des outils informatiques sont prévus pour consigner les informations recueillies, avec toutes les questions que posent l’utilisation et la diffusion des données consignées.
En psychiatre, récemment la loi du 5 juillet 2011, avec les audiences publiques obligatoires auprès du JLD, le droit au secret professionnel est entré en conflit d’intérêt avec un autre droit : celui de la justice nécessairement rendue publiquement. Tout un chacun peut donc assister à ce qui se dit sur son voisin. Les conseils locaux de santé mentale (CLSM) sont également un risque de partage d’information élargie autour de certains de nos patients, j’y vois parfois une sorte de CPU de droit commun. Il semble toujours difficile de faire la part des choses entre les réunions de coordination où sont traités utilement les organisations et le débordement sur les questions individuelles. Le président de la conférence des présidents de CME des CHS, Christian Müller, dans sa contribution écrite au rapport Devictor30, à propos des conseils locaux de santé dont les CLSM pourraient être des sous-commissions, précise que : « Les problématiques individuelles n’ont pas à y être abordées ainsi que la transmission d’informations nominatives ».
Pourtant l’épandage des informations à caractère personnel se poursuit dans la droite ligne de ces évolutions avec l’actuel projet de loi de santé qui prévoit un échange d’information quelle que soit la qualité du professionnel aussi bien sur les plans sanitaire, que social ou médicosocial (Tableau 11) alors que le texte actuel, encore en vigueur, mais pour combien de temps issu de la loi Kouchner de 2002, définissait le secret médical avec exactitude comme un échange entre professionnels de santé participant à la prise en charge du patient (Tableau 12). Évidemment à cette époque, la loi s’intitulait relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; la présente loi ne se nomme pour l’instant que projet de loi relatif à la santé.
- Rapport Devictor, Le service public territorial de sante - le service public hospitalier, Développer l’approche territoriale et populationnelle de l’offre en santé, la Documentation française, mars 2014 :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2F www.ladocumentationfrancaise.fr%2Fvar%2Fstorage%2Frapports-publics%2F144000233%2F0000.pdf&ei=mnZoVO67AYr3O-fOgOgK&u sg=AFQjCNFAebl93ED9qeyamVtYbyYOFLWmqA&bvm=bv.79142246,d.ZWU
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge à condition qu’ils participent tous à la prise en charge du patient et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou de son suivi médico-social et social.
Tableau 11. Art. 1110-4 modifié dans l’actuel projet de loi de santé relatif au secret médical
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.
Tableau 12. Art. 1110-4 du code de la santé publique relatif au secret médical
Alors que le secret médical a été institué, non seulement pour assurer la confidentialité des soins, mais aussi comme l’énonce la jurisprudence comme une disposition d’ordre public, nous assistons actuellement à un renversement où est privilégié l’échange d’informations, dans les CPU ou les CLSM qui concernent une personne afin de mieux assurer la sécurité collective et le respect de l’ordre public (prévention de la récidive, suppression des troubles à l’ordre public causée par les personnes souffrant de troubles mentaux).
Enfin, que dire de la vidéosurveillance qui se généralise dans les différents lieux de soin que ce soit en prison ou dans les hôpitaux psychiatriques. Dans plusieurs établissements pénitentiaires, il faut lutter contre la présence des surveillants dans les salles d’activité de groupe ou la mise en place de vidéosurveillance non seulement dans les couloirs des unités sanitaires, mais parfois dans les salles d’activité thérapeutique31. Et à côté de ces dispositifs mis en place pour des motifs sécuritaires, le SMPR de Rennes est en droit de retrait depuis un mois à ce jour pour défaut chronique des alarmes dans les lieux de soin… Et l’absence d’alarmes dans les unités sanitaires des prisons reste pourtant encore trop fréquente tout en préférant installer des caméras qui répondent bien à l’obsession panoptique pénitentiaire. Sans oublier que la capacité des chefs de pôle à orienter une politique de soins dans leurs services est pour le moins extrêmement limitée depuis la loi HPST. L’éthique est soumise aux diktats économiques et sécuritaires. Si les SMPR ou les dispositifs psychiatriques dans les unités sanitaires (ex UCSA) n’ont pas le soutien des directions des hôpitaux et de la communauté médicale (dont la CME), il en est fini des soins en milieu pénitentiaire qui seront soumis aux tensions délétères et aux déchirements émotionnels consubstantiels au milieu complexe de la prison. Mais cette « analyse systémique », ce regard croisé, se retrouvent aussi à l’hôpital psychiatrique, mais sans l’oppression et l’isolement inhérents au monde carcéral.
La parole est un truc pour se défendre. Mais ici, où je suis à l’instant même, la parole c’est rien, parce que si vous parlez de trop, c’est le mitard.
Amour Mohamed
- Ces situations illustrent une remarquable hypocrisie collective : pénitentiaire et justice demandent des attestations de consultations alors que la pénitentiaire contrôle tous les mouvements de la prison.
Pour conclure : Un enfermement psychique collectif insidieux
L’argumentaire de cette journée situe dans nos pratiques quotidiennes les restrictions aux libertés d’aller et venir. Pourquoi et comment en sommes-nous venus à recourir de plus en plus aux mesures de contention et d’isolement ? À recueillir les événements indésirables, même les plus futiles ? À redouter toutes prises de risque dans nos pratiques, pourtant inévitables ? À accepter que les personnes souffrant de troubles mentaux soient en prison et non à l’hôpital ? À se contenter d’afficher, pour se donner bonne conscience droits et chartres sans pour autant les appliquer ? À élaborer et respecter les protocoles davantage pour se rassurer et nous protéger plutôt que pour améliorer nos pratiques ?
Évidemment le facteur économique et financier a un rôle important dans les évolutions avec les restrictions de moyens. La technicité aussi à une fonction déshumanisante et chronophage bien connue. Les systèmes d’information complexes, souvent en panne, pas très conviviaux et qui ont placé l’écran d’ordinateur devant nos patients ne nous aident pas.
Les procédures, les protocoles qui finissent le plus souvent dans un classeur introuvable contribuent à ce que des sociologues nomment la « functional stupidity »32 et donc une absence d’élaboration, mais l’application mécanique d’un schème d’action d’où il ne faudrait déroger sous aucun prétexte. Si ces modalités sont utiles dans certains domaines très techniques, elles s’allient souvent mal avec une approche relationnelle qui à chaque fois doit être individualisée. La « functional stupidity » s’est installée insidieusement à partir d’outils mis progressivement en place par nos institutions comme la HAS, la création des pôles, les CME devenus d’atones chambres d’enregistrement des décisions directoriales et de caution du calendrier administratif règlementaire, l’abandon de la fonction intégrative et rassemblante du Secteur, le rapprochement de la psychiatrie et de la médecine (internat, IDE, SROS, etc.), etc. L’ensemble, tel un rouleau compresseur emballé, conduit à l’abandon d’une dynamique de résistance et de propositions, sauf chez quelques-uns comme le collectif des 39 par exemple.
L’acmé de la décérébration collective a été atteinte avec la création de la rétention de sûreté en 2008 où les psychiatres ont malheureusement un rôle important à jouer. Impossible aussi de détailler ici les innombrables contradictions juridiques liées à la rétention de sûreté qui ont été largement débattues par les professionnels concernés et dont on peut trouver une analyse serrée dans le livre de Mireille Delmas-Marty « Libertés et sûretés dans un monde dangereux »33 ou dans le rapport du CGLPL sur la rétention de sûreté34 qui illustre une dérive de ce dispositif qui est une honte pour la République que la majorité actuelle s’était engagée à abolir, mais qui semble y renoncer après avoir manqué de peu l’occasion dans la loi Taubira.
Dix années de lois sécuritaires nous ont conduits à accepter que des personnes souffrant de graves troubles mentaux soient incarcérées et que leur droit à aller et venir se limite à être ballotées de prison en asiles (dans la mauvaise acception du terme). S’il est bien un objectif de notre société de trouver un équilibre entre sécurité individuelle et collective et liberté d’expression, il nous faut constater que l’époque actuelle privilégie la sécurité à la libre parole. Les organisations hospitalières ne se prêtent plus au dialogue et à l’échange. Les conflits hospitaliers sont nombreux et violents. Pour terminer, un exemple de parole confisquée et où l’on voit que les regards croisés entre hôpital et prison sont finalement assez aisés. La loi pénitentiaire de 2009 a instauré la consultation des personnes détenues sur les activités qui leur sont proposées (Tableau 13). Cette disposition légale engendre la foudre des syndicats pénitentiaires (Tableau 14).
Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, les personnes détenues sont consultées par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.
Tableau 13. Article 29 de la loi pénitentiaire de 2009
La consultation des personnes détenues
- Alvesson M, Spicer A. A Stupidity-Based Theory of Organisations, Journal of Management Studies 49, 7 Nov. 2012
- Delmas-Marty M. Libertés et sûreté dans un monde dangereux, La couleur des idées, Seuil, Paris, 2010.
- http://www.cglpl.fr/2014/avis-relatif-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-retention-de-surete/
« Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, les personnes détenues sont consultées par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées », stipule le fameux article. Cette simple phrase fait émerger le fantasme de « syndicats de détenus » chez les surveillants. « Nous, on l’interprète comme cela lance Stéphane Lecerf, délégué UFAP-UNSA-Justice, l’une des organisations principales. Il y aurait peut-être des représentants de prisonniers, ils pourraient demander par exemple plus de séances de sport. » FO-Pénitentiaire gronde dans un tract : « Sous couvert de gentilles petites réunions pour savoir si telle ou telle année nos chers pensionnaires vont faire du Scrabble ou du tricot, la garde des Sceaux abat le mur qui nous sépare des comités de détenus et à moyen terme des syndicats de détenus !
Tableau 14. Les réactions de syndicats pénitentiaires à l’article 2935
La justice administrative n’aide pas à l’application de ce texte. En janvier 2008, 208 personnes détenues du centre pénitentiaire de Baie-Mahault en Guadeloupe adressaient une pétition à l’OIP pour dénoncer leurs conditions de détention. Elles demandaient « que soit mis en place un forum de réflexion ou un cahier de doléance afin que des plaintes puissent être enregistrées et consultées, dans le but d’éviter les conflits entre surveillants et détenus ainsi que de trouver des solutions rapides à des problèmes devenus trop récurrents ». L’OIP a saisi le juge administratif qui a rejeté la requête de l’OIP tout en reconnaissant que « les violences à l’encontre du personnel du centre pénitentiaire de Baie-Mahault et entre détenus sont fréquentes, du fait, en particulier, des conditions de détention difficiles dues à la promiscuité et à l’insuffisance des activités proposées en détention » et que « la concertation [peut] contribuer à l’apaisement des tensions ». Mais il rejette l’ensemble des demandes de l’OIP en considérant que la libération de la parole des personnes détenues n’est pas « à elle-seule de nature à prévenir ou faire cesser des atteintes au droit à la vie ou des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Et l’OIP de citer un arrêt de la cour européenne des droits de l’homme rendu en décembre 1976 à Strasbourg où réunit en assemblée plénière la Cour considéra que : « Son rôle de surveillance commande à la Cour de prêter une extrême attention aux principes propres à une ‘société démocratique’. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de pareille société, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les ‘informations’ ou ‘idées’ accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de ‘société démocratique’. Il en découle notamment que toute ‘formalité’, ‘condition’, ‘restriction’ ou ‘sanction’ imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi ».36
Mais nous en psychiatrie, sommes-nous prêts à partager cette parole avec ceux que la maladie mentale - pathologie de la liberté - comme disait Henry Ey, rend parfois si hésitante et maladroite ? Nos institutions, nos autorités de contrôle, nos règlements, nos services, nos équipes nous permettent-ils de le faire ? Le risque serait-il trop grand de parler ?
En fait, le titre de ma communication en forme d’oxymores est une provocation, mais présente un soupçon de vérité. Les personnes détenues se semblent plus libres en prison qu’à l’hôpital psychiatrique et bien que les soins libres doivent être la priorité en psychiatrie, la logique de l’enfermement, qu’elle se cantonne aux murs ou aux excès des psychotropes, est encore très présente.
Comme l’annonce l’argumentaire de nos journées : “Il reste du chemin à parcourir”.
- La Voix du Nord, Plana Radenovic, 20/06/2014 http://www.lavoixdunord.fr/region/des-syndicats-de-detenus-un-article-de-la-loi-ia0b0n2223391
- Cour européenne des Droits de l’Homme. Affaire Handyside c. Royaume-Uni. http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-62057#{% 22 itemid%22:[%22001-62057%22]}
QUESTIONS DANS LA SALLE
Question : Je travaille dans une UMD. Il est extrêmement difficile de travailler avec des patients reconnus irresponsables par la justice (abolition du discernement, art. 122-1 du Code pénal), car quand ils se montrent violents, il est impossible de faire passer l’interdit ; ils répondent qu’ils sont irresponsables. Ne serait-il pas possible qu’ils soient quand même condamnés même s’ils ne restent pas en prison ?
Réponse MD : Il s’agit d’un vieux débat. La condamnation pénale permettrait la “déflorclusion du nom du père”. En somme, elle ramènerait la personne dans la réalité alors que le non-lieu l’en aurait éloigné. Manifestement, la condamnation d’une personne souffrant de schizophrénie grave ne l’a jamais guéri de sa maladie. Mettre sur le compte du non-lieu une impossibilité de travailler avec un patient est à mon sens une erreur grave et une incompréhension volontaire ou non du sens des mots. En effet, un non-lieu ne veut pas dire que l’infraction n’a pas eu lieu, mais qu’il n’y a pas lieu, pour le magistrat, de poursuivre le sujet, car l’infraction n’est pas constituée, car incomplète. En effet, une infraction doit comporter trois éléments : un élément légal (l’infraction existe dans le Code pénal, c’est le principe de légalité des peines et des délits ; par exemple l’homosexualité et l’adultère ne sont actuellement plus des infractions alors que ces deux situations l’étaient dans le passé) ; un élément matériel (les faits doivent être matériellement constatés : un cadavre, des constatations médicales de coups et blessures, un objet volé, etc.) ; et un élément moral, c’est-à-dire que le discernement de la personne n’est pas aboli et qu’elle dispose de toutes ses capacités psychiques pour commettre l’infraction. Quand un patient vante son irresponsabilité pour justifier une impunité permanente pour tout ce qu’il peut faire d’illégal, je le conteste vertement en reprenant l’argument que je viens d’exposer et en faisant bien la distinction entre les actes qu’il a réellement commis et “l’excuse” pénale dont il a bénéficié (ou maléficié pour certains). Bien entendu, ce propos abrupt, ramenant à la réalité, s’ajuste à l’état clinique de la personne et parfois le déni est tellement important qu’il est délicat de l’affronter brutalement, si ce n’est de courir le risque, en levant totalement ou partiellement le déni, de réveiller des angoisses d’anéantissement considérables, pouvant aboutir au suicide. Le non-lieu juridique pour le patient signe son irresponsabilité, mais pas celle des soignants.
Question : Pour les personnes condamnées et hospitalisées en D398 à l’hôpital psychiatrique, la peine continuet-elle à courir ?
Réponse MD : Absolument. Le temps passé à l’hôpital est compté comme à la prison sur la durée de la peine. Si une personne est condamnée à un an d’emprisonnement et qu’elle passe un an à l’hôpital, elle aura “fait” sa peine. Mais cela est-il pour vous un problème ? Réponse de la personne dans la salle : non, mais souvent les détenus ne le savent pas.
MD : les personnes détenues connaissent très bien ces situations. Et si elles ne le savent pas quand elles sont hospitalisées, alors cela signifie qu’elles ont vraiment besoin de l’être, qu’elles ont un réel problème psychique. Je n’avais jamais pensé à cet indicateur, mais à bien y réfléchir, il me semble que cette méconnaissance pourrait être considérée comme un bon indicateur d’hospitalisation…
Article paru dans la revue “Le Syndical des Psychiatres des Hôpitaux” / SPH n°09

