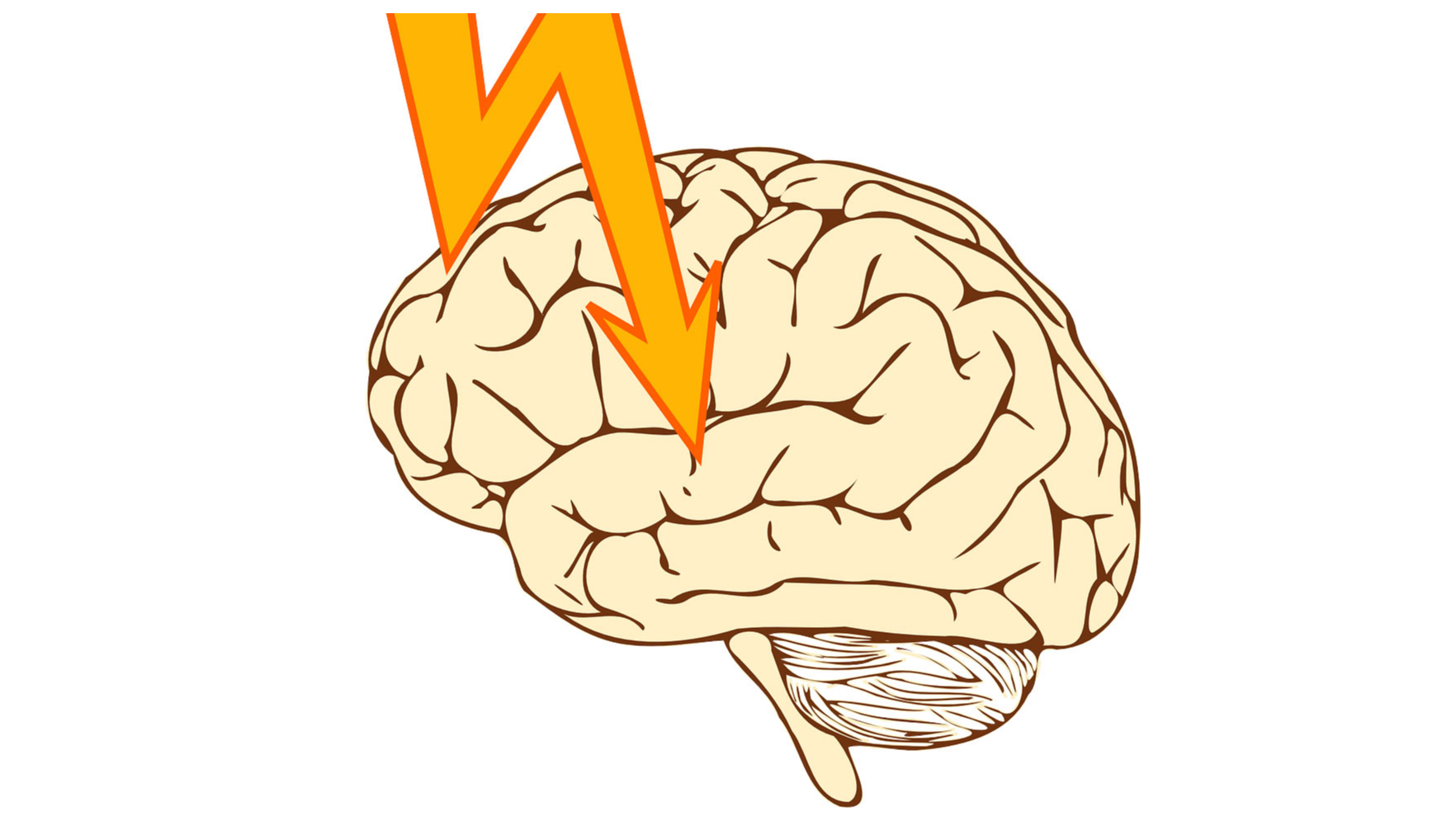
Contexte
L’écoute continue de l’activité atriale permise par les dispositifs électroniques cardiaques implantables (DECI) peut mettre en évidence des épisodes d’arythmie atriale rapide, asymptomatiques, chez des patients qui ne sont pas connus pour présenter une fibrillation atriale (FA) clinique (enregistrement ECG de surface inscrivant une FA de plus de 30 s ou impliquant la totalité d’un tracé de 10 s). Ces évènements sont classiquement définis à partir d’une fréquence atriale de 180 min-1 pendant une durée d’au moins 6 min et sont qualifiés de FA infraclinique lorsque la relecture recommandée des enregistrements confirme une arythmie (1). En effet, la majorité des épisodes de plus courte durée ne sont pas des arythmies (2). La FA infraclinique concerne environ 10 % des porteurs de DECI à 3 mois de l’implantation (3) et 30 % de tous les porteurs de DECI (4).
La FA infraclinique est associée à un risque environ doublé d’accident vasculaire cérébral (AVC) et d’embolie systémique (5) mais qui reste inférieur à celui de la FA clinique (6). Ce risque est plus grand en cas de score CHA2DS2-VASc élevé (3, 7) et de charge importante en FA infraclinique (7, 8) (figure 1).
Figure 1 : Risque annuel d’AVC et d’embolie systémique en fonction de la catégorie de FA et du score CHA2DS2-VASc en l’absence d’anticoagulation. Les cases remplies en rouges affichent un risque supérieur au seuil annuel de 1 % habituellement retenu pour indiquer une anticoagulation (9). Les cases encadrées en vert, jaune et orange représentent respectivement des situations faisant l’objet de recommandations européennes de grade I, IIa et IIb pour anticoagulation chez un homme (1). Adapté à partir des données de Kaplan et al. (7) pour les 3 colonnes de gauche et des données de Singer et al. (10) et Lip et al. (11) pour la colonne de droite.
La question du recours aux anticoagulants oraux (ACO) pour la prévention du risque thrombo-embolique dans la FA infraclinique se pose depuis une dizaine d’années (12). Les dernières recommandations s’accordent à proposer un ACO pour des épisodes de plus de 24 heures avec un score CHA2 DS2 -VA ≥ 2 (grade IIa pour les recommandations états-uniennes et grade IIb pour les recommandations européennes, niveau de preuve B) (1, 9, 13) sur la base de données observationnelles (14) (figure 1). Concernant les épisodes de plus courte durée, les recommandations américaines laissent une possibilité de discuter un ACO avec un score CHA2 DS2 -VA ≥ 3 (grade IIb, niveau de preuve B) (9) malgré une littérature discordante sur le risque thrombo-embolique dans cette situation (7, 8). L’étude d’un registre aux États-Unis a d’ailleurs montré de grandes disparités dans les pratiques à ce sujet (14) et les résultats de deux essais contrôlés randomisés étaient attendus avec impatience pour argumenter la question.
NOAH-AFNET 6
Les résultats de l’étude NOAH-AFNET 6 (15) ont été publiés fin 2023. Dans cette étude, les auteurs ont évalué l’edoxaban (anticoagulant oral anti-Xa direct non commercialisé en France) contre un placebo chez des patients âgés de plus de 65 ans présentant une FA infraclinique quelle qu’en soit la charge avec un score CHA2DS2-VA ≥ 2.
Au total, 2608 patients ont été inclus, majoritairement de sexe masculin (63 %), avec un âge moyen de 77 ans et des épisodes de FA infraclinique d’une durée maximale médiane de 2,8 heures (IQR 0,8-9,4 h). Le score CHA2DS2-VASc médian des patients inclus était de 4 (IQR 2-5). 54 % des patients présentaient une indication à une anti-agrégation plaquettaire par aspirine (ASA) et ceux-ci ont reçu soit de l’edoxaban en monothérapie (groupe testé), soit de l’aspirine en monothérapie (groupe contrôle) au cours de l’étude.
Au terme d’un arrêt prématuré de l’étude suite à un signal de futilité après un suivi médian de 21 mois, le critère de jugement principal comprenant décès cardiovasculaire, AVC et embolie systémique était retrouvé chez 3,2 % des sujets du groupe testé contre 4,0 % des sujets du groupe contrôle (HR 0,81 IC95 % 0,60-1,08) (figure 2A). En revanche, le critère de jugement composite de tolérance comprenant décès toute cause et saignement majeur était retrouvé chez 5,9 % des sujets du groupe testé contre 4,5 % des sujets du groupe contrôle (HR 1,31 IC95 % 1,02-1,67) (figure 2B).
Figure 2 : Courbes d’incidence cumulée du critère de jugement principal comprenant décès cardiovasculaire, AVC et embolie systémique (figure 2A) et du critère de jugement composite de tolérance comprenant décès toute cause et saignement majeur (figure 2B) dans l’étude NOAH-AFNET 6
ARTESiA
Moins de 3 mois plus tard, les résultats de l’étude ARTESiA (16) ont été publiés dans la même revue. Cette fois, les auteurs ont évalué l’apixaban contre l’ASA chez des patients âgés de plus de 55 ans présentant une FA infraclinique de durée comprise entre 6 minutes et 24 heures sur les mémoires de leur DECI avec un score CHA2 DS2 -VASc ≥ 3.
4012 patients ont été inclus, majoritairement de sexe masculin (64 %) avec un âge moyen de 77 ans et des épisodes de FA infraclinique d’une durée maximale médiane de 1,5 heures (IQR 0,2-5,0 h). Le score CHA2 DS2 -VASc moyen des patients inclus était de 3,9 (σ 1,1) et 57 % des patients étaient traités par ASA. Ce traitement a été poursuivi au cours de l’étude.
Malgré un arrêt prématuré au terme d’un suivi moyen de 46 mois à cause d’une perspective limitée d’évènements, le critère de jugement principal comprenant AVC et embolie systémique était retrouvé chez 2,7 % des sujets du groupe testé contre 4,3 % des sujets du groupe contrôle (HR 0,63 IC95 % 0,45-0,88) (figure 3). Par ailleurs, un saignement majeur était retrouvé chez 4,3 % des sujets du groupe testé contre 2,4 % des sujets du groupe contrôle (HR 1,80 IC95 % 1,26-2,57).
Figure 3 : Courbes d’incidence cumulée du critère de jugement principal comprenant AVC et embolie systémique dans l’étude ARTESiA
Méta-analyse
Les populations incluses dans ces deux études sont proches malgré quelques divergences de critères d’éligibilité. En particulier concernant le risque thrombo-embolique, la distribution des scores CHA2 DS2 -VASc paraît similaire et la majorité des plus longs épisodes de FA infraclinique était de durée inférieure à 6 h dans les deux populations. Aussi, le choix du comparateur ne constitue pas un obstacle sérieux à la réunion de ces deux études. En effet, si tous les patients du groupe contrôle de l’étude ARTESiA étaient traités par ASA, la majorité (54 %) des patients du groupe contrôle de l’étude NOAH-AFNET 6 l’étaient également.
Un premier constat notable dans ces études est la faible incidence des évènements thrombo-emboliques, en particulier des AVC. En effet, l’incidence annuelle des AVC et embolies systémiques dans le groupe contrôle était de 1,5 % dans l’étude NOAH-AFNET 6 (contre 1,9 % attendu dans le protocole) et de 1,3 % dans l’étude ARTESiA (contre 2,8 % attendu dans le protocole). Pour rappel, cette même incidence était de 1,7 % dans l’étude ASSERT (3) composée de patients présentant une FA infraclinique avec un score CHA2 DS2 -VASc ≥ 1 et de 3,7 % dans le groupe contrôle de l’étude AVERROES(17) composé de patients présentant une FA clinique avec un score CHA2 DS2 -VASc ≥ 1 et traités par ASA. Cette incidence limitée d’évènements thrombo-emboliques peut être liée (i.) à la faible charge initiale d’arythmie dans les deux populations (3e quartile de durée maximale d’épisode de 9,4 h pour NOAH-AFNET 6 et de 5,0 h pour ARTESiA) et (ii.) au suivi rapproché permettant une identification et un traitement précoce de la FA clinique (et de la FA infraclinique de plus de 24 h dans l’étude ARTESiA).
Malgré cette incidence limitée d’évènements, l’analyse principale de l’étude ARTESiA met en évidence une réduction statistiquement significative des AVC et des embolies systémiques (HR 0,63 IC95 % 0,45-0,88). Une taille d’effet similaire a été observée pour les mêmes évènements dans l’étude NOAH-AFNET 6 mais cette dernière a certainement manqué de puissance pour atteindre la significativité statistique (HR 0,69 IC95 % 0,41-1,18). Ce manque de puissance est corroboré par une méta-analyse des deux études impliquant les auteurs de chacune (18) et mettant en évidence une réduction relative statistiquement significative de 35 % du risque d’AVC et d’embolie systémique (RR 0,65 IC95 % 0,49-0,86, I2 0 %).
Un deuxième constat important dans ces études est la confirmation d’une augmentation significative du risque de saignement majeur sous ACO (définition ISTH (19)). En effet, cette méta-analyse met en évidence une augmentation relative du risque de saignement majeur de 62 % (RR 1,62 IC95 % 1,05-2,50, I2 61 %). Il faut également tenir compte que le comparateur était l’aspirine pour 82 % de la population de cette méta-analyse, une thérapeutique déjà associée à un risque hémorragique accru (20). Pour autant, il n’y a pas de signal d’alerte concernant les saignements conduisant au décès (RR 0,79 IC95 % 0,37-1,69, I2 0 %). Enfin, il faut noter également une congruence des deux études quant à une augmentation de la mortalité toute cause, sans significativité statistique (RR 1,08 IC95 % 0,93-1,21, I 2 0 %).
Discussion
Bien que discordantes à première vue, ces deux études présentent des résultats homogènes qui font état d’un bénéfice à l’anticoagulation de la FA infraclinique pour une réduction relative du risque d’AVC et d’embolie systémique de 35 % au prix d’une augmentation relative du risque de saignement majeur de 62 %. Ces modifications relatives sont à mettre en perspective avec l’incidence annuelle de ces deux catégories d’évènements respectivement de 1,34 % et de 1,07 % dans la population des deux études réunies. Cela signifie que pour une population de 1000 patients, un tel traitement permettrait approximativement d’éviter 5 AVC ou embolies systémiques au prix de 7 saignements majeurs.
Ces chiffres laissent penser que ces deux études se positionnent à la limite de l’équilibre de la balance bénéfice-risque de l’anticoagulation pour la prévention du risque thrombo-embolique. Sachant la quantité et la variété des patients inclus dans ces deux études, des analyses supplémentaires pourraient permettre d’identifier des sous-groupes de patients pour lesquels cette balance bénéfice-risque est plus intéressante.
Dans l’attente, la décision d’une anticoagulation en cas de FA infraclinique doit tout particulièrement être prise en fonction du risque thrombo-embolique (score CHA2 DS2 -VASc et charge en FA infraclinique essentiellement) mais aussi du risque hémorragique (score HAS-BLED (21)). Dans tous les cas, la prise en charge des facteurs de risque modifiables de saignement et de thrombo-embolie s’impose (1). L’avis du patient a également une place particulière dans cette situation car un AVC ou une hémorragie n’ont pas la même signification pour tous. En effet, les patients rapportent globalement une plus grande crainte des AVC que des saignements en comparaison aux médecins (22) et 45 % d’entre eux considèrent un AVC avec parésie séquellaire d’un membre comme une issue plus grave que le décès (23).
Enfin, deux messages supplémentaires sont probablement à retirer de la faible incidence des évènements thrombo-emboliques dans ces études.
Le premier concerne la surveillance rapprochée avec interrogatoire et électrocardiogramme semestriels dont ont bénéficié les patients inclus dans les deux études. Ce suivi a permis d’identifier chaque année 9 % des patients de l’étude NOAH-AFNET 6 progressant vers une FA clinique et 24 % des patients de l’étude ARTESiA ayant développé au moins un épisode de FA infraclinique de plus de 24 h ou une FA clinique. Ces patients ont tous bénéficié d’un ACO s’ils n’étaient pas déjà dans un groupe testé. Sur le plan statistique, ces patients à plus haut risque ont été exclus des analyses sur les critères d’efficacité dans l’étude NOAH-AFNET 6, ce qui a dû conduire à une diminution de l’incidence attendue des évènements thrombo-emboliques dans les deux groupes. Dans l’étude ARTESiA, ces patients ont été maintenus dans les analyses sur les critères d’efficacité, ce qui a dû conduire à une diminution de l’incidence attendue des évènements thrombo-emboliques dans le groupe contrôle grâce à une protection des patients à plus haut risque par ACO. Si le risque de progression vers une charge plus importante en FA infraclinique (24) ou vers une FA clinique (3) était connu, ces études laissent penser que l’abstention sous condition de surveillance rapprochée est une attitude raisonnable car elle permet une diminution des évènements thrombo-emboliques en identifiant précocement les évolutions vers des profils à plus haut risque.
Le deuxième est lié à la faible charge initiale d’arythmie dans les deux populations qui a également participé, au moins partiellement, à limiter ces évènements thrombo-emboliques. Cette constatation réaffirme l’importance de la charge en arythmie pour argumenter le risque thrombo-embolique comme cela était déjà connu notamment pour la FA paroxystique en opposition à la FA persistante ou permanente (25). Ceci ne fait que conforter l’intérêt d’un contrôle du rythme précoce en cas de FA pour réduire les évènements thrombo-emboliques comme cela était suggéré dans l’étude EAST-AFNET 4 (26).
Les points clés à retenir
- Ces deux études au design similaire s’accordent à montrer un bénéfice à l’anticoagulation de la FA infraclinique pour la première fois avec un haut niveau de preuve (réduction relative du risque d’évènements thrombo-emboliques de 35 %) ;
- Ce bénéfice s’accompagne d’une augmentation significative des saignements majeurs : environ 7 saignements majeurs pour 5 AVC ou embolies systémiques évités chez 1000 patients traités ;
- Cette balance bénéfice-risque apparemment discutable pourrait être précisée en sous-groupes afin d’identifier les patients avec un profil plus favorable au traitement ;
- Ces résultats devraient conduire à conforter les futures recommandations sur l’anticoagulation de la FA infraclinique au grade II mais avec un niveau de preuve majoré ;
- Dans l’attente, la décision d’anticoagulation d’une FA infraclinique doit tout particulièrement prendre en compte l’avis du patient concerné et sa perception des risques thrombo-emboliques et hémorragiques.
Annexe 1 : Résumé des études ARTESiA et NOAH-AFNET 6 tiré de l’article de l’éditorial de Svennberg (27).
Auteur
Hugo VILMIN
CHU de Nancy
Relecteur
Dr Jean-Marc SELLAL
CHU de Nancy
Références
- Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). EHJ. 2021;42(5):373-498.
- Pollak WM, Simmons JD, Interian A, Atapattu SA, Castellanos A, Myerburg RJ, et al. Clinical Utility of Intraatrial Pacemaker Stored Electrograms to Diagnose Atrial Fibrillation and Flutter. PACE 2001;24(4):424-9.
- Healey JS, Connolly SJ, Gold MR, Israel CW, Van Gelder IC, Capucci A, et al. Subclinical Atrial Fibrillation and the Risk of Stroke. NEJM 2012;366(2):120-9.
- Proietti M, Romiti GF, Vitolo M, Borgi M, Rocco AD, Farcomeni A, et al. Epidemiology of subclinical atrial fibrillation in patients with cardiac implantable electronic devices: A systematic review and meta-regression. EJIM 2022;103:84-94.
- Vitolo M, Imberti JF, Maisano A, Albini A, Bonini N, Valenti AC, et al. Device-detected atrial high rate episodes and the risk of stroke/ thrombo-embolism and atrial fibrillation incidence: a systematic review and meta-analysis. EJIM 2021;92:100-6.
- Mahajan R, Perera T, Elliott AD, Twomey DJ, Kumar S, Munwar DA, et al. Subclinical device-detected atrial fibrillation and stroke risk: a systematic review and meta-analysis. EHJ 2018;39(16):1407-15.
- Kaplan RM, Koehler J, Ziegler PD, Sarkar S, Zweibel S, Passman RS. Stroke Risk as a Function of Atrial Fibrillation Duration and CHA 2 DS 2 -VASc Score. Circulation 2019;140(20):1639-46.
- an Gelder IC, Healey JS, Crijns HJGM, Wang J, Hohnloser SH, Gold MR, et al. Duration of device-detected subclinical atrial fibrillation and occurrence of stroke in ASSERT. EHJ 2017;38(17):1339-44.
- Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, Benjamin EJ, Chyou JY, Cronin EM, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2024;149(1).
- Singer DE, Chang Y, Borowsky LH, Fang MC, Pomernacki NK, Udaltsova N, et al. A New Risk Scheme to Predict Ischemic Stroke and Other Thromboembolism in Atrial Fibrillation: The ATRIA Study Stroke Risk Score. JAHA 2013;2(3):e000250.
- Lip GYH, Nieuwlaat R, Pisters R, Lane DA, Crijns HJGM. Refining Clinical Risk Stratification for Predicting Stroke and Thromboembolism in Atrial Fibrillation Using a Novel Risk Factor-Based Approach. Chest 2010;137(2):263-72.
- January CT, Wann LS, Alpert JS, Calkins H, Cigarroa JE, Cleveland JC, et al. 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation 2014;130(23).
- Andrade JG, Aguilar M, Atzema C, Bell A, Cairns JA, Cheung CC, et al. The 2020 Canadian Cardiovascular Society/Canadian Heart Rhythm Society Comprehensive Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation. CJC 2020;36(12):1847-948.
- Perino AC, Fan J, Askari M, Heidenreich PA, Keung E, Raitt MH, et al. Practice Variation in Anticoagulation Prescription and Outcomes After Device-Detected Atrial Fibrillation: Insights From the Veterans Health Administration. Circulation 2019;139(22):2502-12.
- Kirchhof P, Toennis T, Goette A, Camm AJ, Diener HC, Becher N, et al. Anticoagulation with Edoxaban in Patients with Atrial High-Rate Episodes. NEJM 2023;389(13):1167-79.
- Healey JS, Lopes RD, Granger CB, Alings M, Rivard L, McIntyre WF, et al. Apixaban for Stroke Prevention in Subclinical Atrial Fibrillation. NEJM 2024;390(2):107-17.
- Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C, Diener HC, Hart R, Golitsyn S, et al. Apixaban in Patients with Atrial Fibrillation. NEJM 2011;364(9):806-17.
- McIntyre WF, Benz AP, Becher N, Healey JS, Granger CB, Rivard L, et al. Direct Oral Anticoagulants for Stroke Prevention in Patients with Device-Detected Atrial Fibrillation: A Study-Level Meta-Analysis of the NOAH-AFNET 6 and ARTESiA Trials. Circulation 2023.
- Schulman S, Kearon C. Definition of major bleeding in clinical investigations of antihemostatic medicinal products in non‐surgical patients. JTH 2005;3(4):692-4.
- McNeil JJ, Wolfe R, Woods RL, Tonkin AM, Donnan GA, Nelson MR, et al. Effect of Aspirin on Cardiovascular Events and Bleeding in the Healthy Elderly. NEJM 2018;379(16):1509-18.
- Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R, De Vos CB, Crijns HJGM, Lip GYH. A Novel User-Friendly Score (HAS-BLED) To Assess 1-Year Risk of Major Bleeding in Patients With Atrial Fibrillation. Chest 2010;138(5):1093-100.
- Devereaux PJ, Anderson DR, Gardner MJ, Putnam W, Flowerdew GJ, Brownell BF, et al. Differences between perspectives of physicians and patients on anticoagulation in patients with atrial fibrillation: observational study Commentary: Varied preferences reflect the reality of clinical practice. BMJ 2001;323(7323):1218-1218.
- Samsa GP, Matchar DB, Goldstein L, Bonito A, Duncan PW, Lipscomb J, et al. Utilities for major stroke: Results from a survey of preferences among persons at increased risk for stroke. AHJ 1998;136(4):703-13.
- Boriani G, Glotzer TV, Ziegler PD, De Melis M, Mangoni Di S. Stefano L, Sepsi M, et al. Detection of new atrial fibrillation in patients with cardiac implanted electronic devices and factors associated with transition to higher device-detected atrial fibrillation burden. Heart Rhythm 2018;15(3):376-83.
- Link MS, Giugliano RP, Ruff CT, Scirica BM, Huikuri H, Oto A, et al. Stroke and Mortality Risk in Patients With Various Patterns of Atrial Fibrillation: Results From the ENGAGE AF-TIMI 48 Trial (Effective Anticoagulation With Factor Xa Next Generation in Atrial Fibrillation–Thrombolysis in Myocardial Infarction 48). Circ AE 2017;10(1):e004267.
- Kirchhof P, Camm AJ, Goette A, Brandes A, Eckardt L, Elvan A, et al. Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation. NEJM 2020;383(14):1305-16.
- Svennberg E. What Lies beneath the Surface — Treatment of Subclinical Atrial Fibrillation. NEJM 2024;390(2):175-7.

