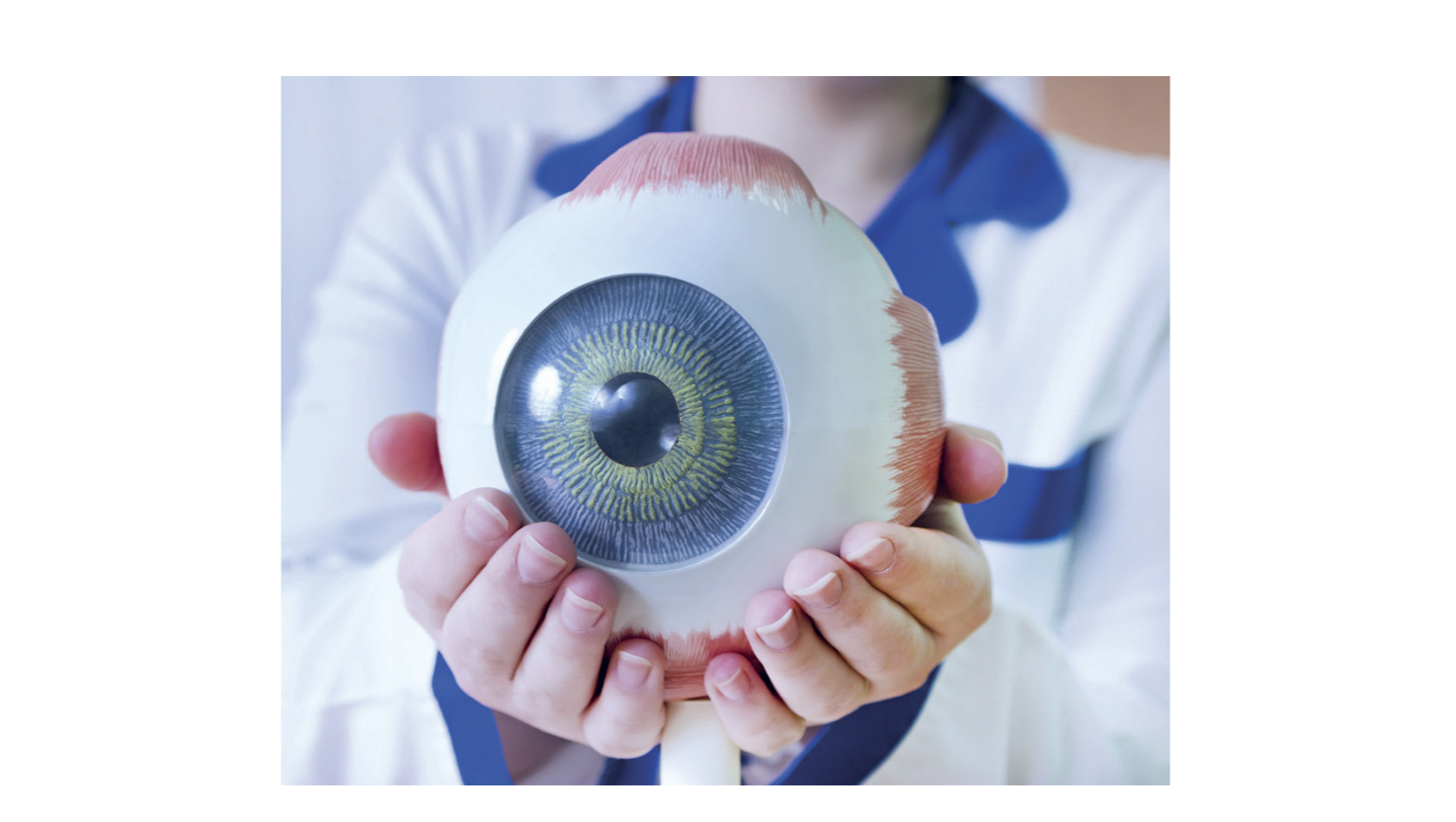
L'orbitopathie dysthyroïdienne est une maladie auto-immune qui représente la manifestation extra-thyroïdienne la plus fréquente. Elle peut se voir dans un contexte d'hyperthyroïdie le plus fréquemment (maladie de Basedow ou graves disease) parfois d'hypothyroïdie (thyroïdite d'Hashimoto) ou d'euthyroïdie (fonctionnement normal de la thyroïde). [1] La maladie de Basedow est la première cause d'hyperthyroïdie et elle est 5 fois plus fréquente chez la femme. [2]
L'orbitopathie dysthyroïdienne atteint toutes les structures orbitaires. Elle associe classiquement et de façon plus ou moins complète une exophtalmie à des rétractions palpébrales, des troubles oculomoteurs et une hypertension oculaire. Elle évolue en deux phases : une phase inflammatoire, durant de douze à vingt-quatre mois, suivie d'une phase séquellaire où s'installent les phénomènes de fibrose. [3] L'atteinte est classifiée selon le score CAS (Clinical Activity Score), qui oriente vers l'intérêt d'un traitement anti-inflammatoire :
CAS (Clinical Activity Score)selon l'European Group On Graves Orbitopathy
Inflammation orbitaire si ≥ 3 points
(chaque signe clinique observé compte pour 1 point Douleurs spontanées rétro-oculaires
Douleurs lors des mouvements oculaires
Rougeur de la paupière (pseudo-blépharite)
Rougeur de la conjonctive
Chémosis
Œdème de la paupière
Œdème de la caroncule et/ou du repli semi-lunaire Figure 1 : Score CAS [2]
Le bilan orthoptique
L'atteinte oculomotrice est fréquente au cours des orbitopathies dysthyroïdiennes. Liée à la fibrose musculaire, elle réalise au stade séquellaire une myopathie restrictive, responsable d'une diplopie et/ou de limitations oculomotrices invalidantes.
Le bilan orthoptique définit les caractères de la diplopie : direction (verticale, horizontale ou mixte), incomitance, permanence, positions compensatrices. Il évalue les limitations oculomotrices.
Il permet également de quantifier les déviations. Les schémas coordimétriques indispensables et répétés objectivent les restrictions musculaires et les hyperactions secondaires.
Les muscles les plus souvent touchés sont les droits inférieurs, suivis, par ordre de fréquence décroissante, par les droits médiaux puis supérieurs ; l'atteinte des muscles obliques est rare, celle des droits latéraux exceptionnelle. L'atteinte peut être unilatérale ou bilatérale, symétrique ou non, monomusculaire ou plurimusculaire. [3]
Atteinte du droit inférieur : Elle est la forme clinique la plus typique, responsable d'une diplopie verticale par hypotropie et limitation de l'élévation. Dans l'atteinte bilatérale symétrique des droits inférieurs, le patient ne décrit pas de diplopie mais présente une attitude de tête rejetée en arrière, invalidante.
Association de l'atteinte du droit inférieur et droit médial : Elle est très fréquente. Les patients décrivent une diplopie mixte. Si l'atteinte est bilatérale et symétrique, la diplopie est horizontale.
Atteinte d'un droit supérieur : Elle occasionne une diplopie verticale avec limitation de l'abaissement. Elle peut s'associer à l'atteinte du droit inférieur controlatéral.
Atteinte d'un muscle oblique : Elle est rare, le plus souvent associée à l'atteinte d'un droit inférieur ou de plusieurs muscles droits. Elle doit être recherchée car souvent méconnue. Elle associe aux désordres oculomoteurs une composante torsionnelle.
Atteinte d'un droit latéral : Elle est exceptionnelle, associée à celle des autres muscles droits dans des formes plurimusculaires. [3]
Chirurgie
Le traitement chirurgical est de trois étapes non obligatoire :
- La chirurgie de décompression : en phase inflammatoire : permet d'augmenter le volume orbitaire. Cette décompression peut-être osseuse ou également enlever de la graisse (lipectomie).
- La chirurgie des muscles oculomoteurs quand les prismes ne sont pas possibles.
- La chirurgie des paupières : chirurgie de la rétraction palpébrales et/ou blépharoplastie, c'est-à-dire ablation du tissu cutanée et graisseux excessif. [2]
[1]. Daldoul N, Knani L, Gatfaoui F, Mahjoub H. Prise en charge des orbitopathies dysthyroidiennes modérées et sévères : à propos de 22 cas. Pan Afr Med J. 7 août 2017;27:257.
[2]. Aptel F. Collège des Ophtalmologistes Universitaires de France (COUF) 202. 2021;
[3]. Rapport SFO - Strabisme [Internet]. [cité 22 avr 2024]. Disponible sur : https://www.em-consulte.com/em/SFO/2013/html/file_100026.html
Figure 1 : Collège des Ophtalmologistes Universitaires de France (COUF) 202. 2021
Roxane COTTREL

