
Au début du XIXème siècle, les maladies du système nerveux sont peu connues en dehors de lʼapoplexie et de la neurosyphilis (Bayle 1822). Depuis Aristote, le débat sʼest plutôt focalisé sur les rapports âme et corps, théorisé par le dualisme de Descartes et lʼinteraction âme et corps au niveau de lʼépiphyse.
La fin de la doctrine des esprits animaux ventriculaires par Thomas Willis en 1664 donnera ensuite la primauté à la substance grise corticale. Elle ouvrira la voie à la controverse entre Galvani (1786) et Volta (1791) sur la nature électrique de ces esprits de venant influx nerveux. En ce début de siècle, la médecine française est pourtant devenue le fleuron de la médecine d'observation et de la méthode anatomoclinique. Citons parmi les médecins les plus illustres de cette époque, François Xavier Bichat (1771-1802), Jean Nicolas Corvisart (1755-1821) et surtout Théophile René Laennec (1774-1826) pionnier de la « poitrine incognita » et de l'auscultation ; pour la neurologie citons Franz Joseph Gall (1756-1828) et son modèle fantaisiste de la phrénologie, François Magendie (1783-1853) et Pierre Flourens (1794 1865), pionniers de la neurologie expérimentale, Philippe Pinel (1745-1826) et sa classification des vésanies en 1798 et Jean Baptiste Bouillaud (1796 1881), premier à localiser le centre du langage dans les lobes frontaux 10 ans avant la description de l'aire de Broca en 1861. Charles-Édouard Brown Séquard (1817-1894) restera quant à lui célèbre par son syndrome décrit en 1851 et Guillaume Duchenne de Boulogne (1806-1875) devient le père de la physiologie du mouvement et de la sémiologie des lésions du système nerveux périphérique, musculaire et de la moelle.
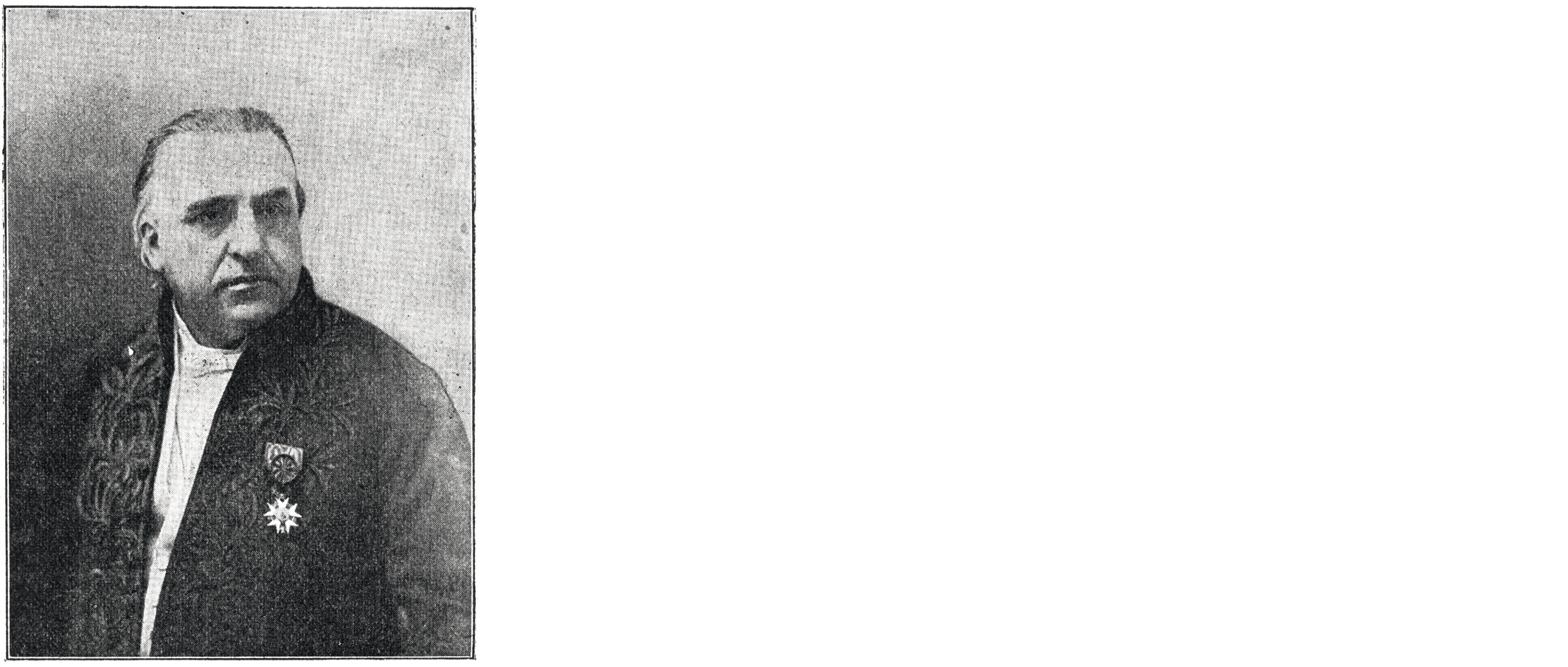
Jean Martin Charcot
Mais celui qui incarne, encore de nos jours, la Neurologie est sans nul doute Jean Martin Charcot (1825-1893). Qui mieux que Octave Mirbeau, chroniqueur à lʼévènement, peut brosser le portrait de cet illustre personnage au début de la IIIème République : « ce siècle sera le siècle des maladies nerveuses, à un double point de vue : dʼabord parce quʼelles auront été maitresses et causes de tous ses actes ; ensuite parce quʼil (Charcot) aura étudié à fond et connu les secrets de son mal. Cʼest pourquoi il ne sera peut-être ni le siècle de Victor Hugo, ni le siècle de Napoléon mais le siècle de Charcot ». Charcot est l'incarnation du positivisme et de la médecine scientifique, colonne vertébrale de l'esprit ré publicain. Interne en 1848, comme son ami Alfred Vulpian, chef de clinique de Rayer alors que se déroulait la guerre de Crimée, il est agrégé d'anatomie pathologique en 1860 puis nommé médecin chef à la Salpetrière en 1866 dans « l'hospice de la vieillesse femmes »1. Il va y créer la plus grande clinique neurologique d'Europe et, eu égard à ses appuis politiques, obtiendra de Gambetta lui-même la première chaire mondiale de neurologie en 1882. Car, n'en doutant pas, à côté de ses qualités scientifiques, Charcot est aussi opportuniste. Marié à une riche veuve, Augustine Victoire, ami des politiques, partisan de l'ordre impérial, il sera ensuite républicain puis anticlérical avant de devenir adepte de la foi qui guérit dans ses derniers écrits. Lors de la présentation de ses leçons, il accueille, à côté de ses internes, les célébrités du moment : les journalistes Paul Arène et Philippe Burty, le grand-duc Nicolas de Russie, le préfet de police Lépine, le Bey de Tunis, le cardinal Lavigerie et des hommes de lettre, Zola, Maupassant, Alphonse et Léon Daudet. Ce dernier le décrit dans les Morticoles comme « le professeur Foutange, entouré de ses collègues les docteurs Tripard et Boustibras (Pierre Marie et Babinski), régnant dans lʼhôpital Typhus, visité par des êtres venus dʼailleurs, où grouillait une foule composite ». L'hôpital est décrit par Charcot lui même comme un vaste pandémonium des misères humaines. « Nous sommes en possession dʼune sorte de musée pathologique vivant dont les ressources sont considérables ». Cette cour des miracles tranche singulièrement avec le style de son hôtel particulier de Varangéville, actuelle maison de l'Amérique latine dans lequel il consultait. En revanche la description caricaturale faite par Victoria Mas2 d'un Charcot metteur en scène de malades femmes devant un Paris masculin bourgeois et misogyne est loin des écrits montrant plutôt un Charcot à l'écoute de ses patientes. En revanche « lʼarrivée du patron, chaque matin, était un petit événement, quelque chose en plus réduit, comme lʼentrée de Bonaparte dans les salons de la Cour, un soir de réception : « messieurs, lʼempereur ! »… il tendait deux doigts à son chef de clinique, un doigt à chacun de ses internes, jetait un regard circulaire méprisant sur les assistants, esquissait un vague sourire à lʼadresse de ses confrères étrangers »3. Mais ce rituel ne s'est-il pas transmis de génération en génération !
Pour évaluer son apport scientifique, Il suffit de lire ses œuvres complètes publiées par Désiré Magloire Bourneville4, pour en prendre conscience. Il va créer la première école européenne de neurologie avec des élèves aussi célèbres que Pierre Marie, Joseph Babinski, Louis Antoine Ranvier, Gilles de la Tourette, Achille Souques, Paul Richer, Alfred Binet, Pierre Janet, Jules Cotard, Sigmund Freud ou Eugène Bleuler. Charcot sera invité partout en Europe et en Amérique. Très attentif aux travaux allemands d'Erb, Strumpel ou Leyden, il n'ira plus outre Rhin après 1870 pour « la revanche scientifique ».
Beaucoup moins célèbre mais tout aussi brillant, Alfred Vulpian (1826 87), interne de la même promotion va créer lui aussi son école à Paris : avant de débuter sa médecine en 1845, il échoue à l'école normale supérieure un an plus tôt mais devient préparateur de P. Flourens, cité plus haut, au muséum national d'histoire naturelle. Il en sera titulaire en 1850. Ami et collaborateur de Charcot pendant près de 30 ans, chef de service comme lui en 1861, il obtient la chaire d'anatomie pathologique en 1867, sera doyen de la faculté de médecine à Paris en 1875 et membre de la commission à l'origine de la loi du 12 juillet 1875 sur la liberté de l'enseignement supérieur. Petit clin d'œil, c'est cette loi qui a permis l'ouverture d'universités non publiques en France et donc de l'université catholique de Lille et ainsi au doyen actuel de sa faculté de médecine de rappeler la mémoire de cet illustre neurologue effacé derrière la personnalité tout aussi éminente de Charcot. Il démissionnera de son poste de doyen en 1881 en réaction à la nomination de l'anti clérical Paul Bert. Moins médiatique que Charcot, Il s'opposera à sa nomination par un homme politique et non par un universitaire à la chaire de Neurologie en 1882. Son apport scientifique est remarquable : maladies de la moelle5, coloration des médullosurrénales et d'une « matière spéciale prenant une teinte rose Carmin », 45 ans avant la découverte de l'adrénaline, leçons sur la physiologie générale et comparée du système nerveux en 1866 et première présentation orale le 09 mai 1866 des 3 observations princeps de sclérose en plaques (dont 2 de Charcot) dans laquelle il fait une distinction « entre tremblement de repos en quelque sorte permanent et tremblement lors de mouvements voulus intéressant les membres et la tête ». Écrasé par le charisme de son rival, leur collaboration prend fin en 1869. Pour autant Vulpian sera-t-il effacé de l'histoire ?
Références
1. Jean Martin Charcot. Pour le centenaire de sa mort. Bonduelle M Sem Hôp Paris 1993 ; 69 : 40-41, 466-1473.
2. Le bal des folles. Mas V. Prix Renaudot 2019.
3. Vécu II. Daudet L. Paris : Gallimard ; 1930 : 92-93.
4. Charcot JM. Œuvres complètes. Leçons sur les maladies du système nerveux (texte imprimé). Recueillies et publiées par Bourneville. Paris : bureau du progrès médical (1892).
5. Maladies du système nerveux. Leçons professées à la faculté de médecine. Vulpian A ; Recueillies et publiées par le Dr Bourceret. Octave Douin, éditeur 1879.

Pr Patrick HAUTECŒUR
Lille

