
Alexandra DUPIC.- Pouvez-vous décrire les principales étapes de votre parcours professionnel ?
PR IGOR SIBON.- J'ai suivi mes études de médecine à Bordeaux, où j'ai effectué mon externat et mon internat, avant de réaliser mon clinicat dans le service de Neuro-vasculaire du Pr Jean-Marc Orgogozo.
Durant mon internat, j'ai consacré une année à un master 2 (anciennement diplome dʼétudes approfondies) sur la sensibilisation médullaire à la douleur sous la direction de Pr Gwendal Le Masson, PU-PH en neurologie. Pour valider mon DES de Neurologie, j'ai présenté mon mémoire portant sur la fibromyalgie et ses anomalies électrophysiologiques, tandis que ma thèse de médecine était consacrée au groupage HLA dans la sclérose en plaques.
Enfin, ma thèse de sciences s'est intéressée à la physiopathologie des anévrismes intra-crâniens et notamment au rôle des amines oxydases dans la destruction de la matrice extracellulaire.
À la suite de mon internat, j'ai effectué 18 mois de post-doctorat à l'Université McGill à Montréal, au sein d'une unité de psychiatrie et d'imagerie moléculaire. Mon objectif était d'explorer l'apport de l'imagerie moléculaire dans la compréhension des pathologies psychiatriques, dans l'optique d'appliquer ces connaissances à mes recherches actuelles sur les troubles de l'humeur post-AVC.
Après cette expérience, j'ai occupé un poste de PH-U à Bordeaux durant trois ans avant d'accéder, en 2009, à mon poste actuel de PU-PH en Neurovasculaire.
A. D.- Quels sont vos projets de recherche actuels ?
PR I. S.- Affilié à l'Institut de Neuro-sciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA), unité mixte de recherche du CNRS et de lʼuniversité de Bordeaux, j'ai l'opportunité de co-diriger une équipe avec Sylvie Berthoz, psychologue, afin d'étudier le handicap invisible post-AVC et ses facteurs prédictifs. Nous adoptons pour cela deux approches complémentaires. La première repose sur la neuro-imagerie en collaboration avec Pr Thomas Tourdias, PU-PH en Neuroradiologie, et Dr Michel Thiebaut de Schotten, spécialiste en neuro-imagerie et neuropsychologie, qui dirige le Groupe d'Imagerie Neuro-fonctionnelle (GIN) à Bordeaux. La seconde s'intéresse à l'étude des troubles cognitifs et, plus particulièrement, des troubles de l'humeur post-AVC en vie quotidienne. Cette approche présente un double intérêt : d'une part, un volet diagnostique visant à mieux comprendre l'impact des fluctuations du quotidien sur ces troubles ; d'autre part, un volet thérapeutique impliquant le développement de stratégies interventionnelles digitales en partenariat avec des acteurs industriels.
Par ailleurs, dans le cadre de l'Institut Hospitalo-Universitaire, je collabore avec Pr Stéphanie Debette, PU-PH en Epidémiologie et Neurologie, sur la maladie des petites artères cérébrales. Notre travail porte à la fois sur la meilleure compréhension de la physiopathologie et sur le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques visant à limiter l'évolution vers des troubles cognitifs et des AVC.
A. D.- Quel est votre rôle en tant que président du collège des enseignants de neurologie ?
PR I. S.- Ma mission principale est de coordonner l'enseignement de la neurologie pour l'ensemble des étudiants en médecine, tout en assurant un lien avec les différentes instances.
Pour le premier cycle, j'ai poursuivi le travail initié par Pr Luc Defebvre, PU PH à Lille, en supervisant la finalisation de la rédaction du référentiel « Les fondamentaux de la Neurologie », qui synthétise les bases essentielles comme l'anatomie, la physiologie et les grands syndromes neurologiques.
Concernant le deuxième cycle, nous nous efforçons d'actualiser les supports pédagogiques comme le référentiel du second cycle et d'intégrer de nouvelles méthodes d'évaluation, telles que les fiches Lisa et les tests de concordance de script, élaborés en concertation avec des panels d'experts. S'agissant des internes, nous mettons régulièrement à jour les supports de formation et supervisons les évaluations de fin de cursus (socle/ approfondissement). Par ailleurs, nous participons activement aux Journées de Neurologie de Langue Française (JNLF), notamment dans le cadre des Journées d'Enseignement Supérieur de Neurologie, et en contribuant à l'élaboration des webinaires. Enfin, nous avons mené des discussions avec le ministère ayant abouti à l'instauration d'une cinquième année de DES, qui entrera en vigueur en novembre 2025. Nous suivons également les réformes en cours, notamment celles liées aux EDN et aux ECOS, en prenant part à la Conférence nationale des collèges de médecine.
A. D.- Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir une carrière en médecine et à devenir PU-PH ?
PR I. S.- À la fin du lycée, j'hésitais entre plusieurs orientations : un cursus en STAPS pour devenir professeur de sport, des études de droit pour intégrer la police – attiré par l'aspect investigateur du métier – ou encore la médecine, influencé par mon beau père, médecin généraliste, dont le métier m'intéressait particulièrement. Dès la première année de médecine, j'ai eu une véritable révélation et j'ai rapidement pris goût aux études médicales. Jusqu'en cinquième année, mon objectif était de devenir médecin généraliste, mais j'ai trouvé la spécialité particulièrement exigeante en raison de l'ampleur des connaissances à acquérir. J'ai alors opté pour la Neurologie, séduisante par sa diversité, couvrant l'ensemble du corps, « du bout des orteils jusqu'au crâne », et offrant de nombreuses sous-spécialités.
Parallèlement, j'ai développé un intérêt marqué pour la recherche, en particulier lors de mon année de recherche. L'enchaînement a ensuite été naturel : j'ai poursuivi avec une thèse de sciences, un post-doctorat et, progressivement, la carrière universitaire s'est imposée comme une évidence.
A. D.- Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien et comment les surmontez-vous ?
PR I. S.- La principale contrainte est celle du temps. Le métier de PU-PH ne se limite pas aux missions cliniques, pédagogiques et de recherche : il comprend également une part non négligeable d'administratif et de gestion. Ce manque de temps impose donc des choix, parfois difficiles, où la raison doit primer sur le cœur. La passion et l'intérêt clinique sont présents, mais ces responsabilités sont particulièrement chronophages. Malgré ces contraintes, la diversité et la richesse du métier rendent l'engagement toujours stimulant.
A. D.- Quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent se lancer dans une carrière universitaire ?
PR I. S.- Le plus important est de s'engager dans un domaine qui vous passionne. La motivation et l'envie sont essentielles pour surmonter les difficultés, qu'elles soient administratives, organisationnelles ou liées aux exigences académiques (publications, concours, incertitudes sur les postes disponibles). Il faut persévérer et y consacrer du temps. De plus, disposer d'une organisation personnelle bien structurée est indispensable pour ne pas se disperser. Un bon soutien familial et un environnement de travail bienveillant sont également des atouts majeurs, car on ne devient pas PU-PH seul : c'est un travail d'équipe et il est essentiel de s'entourer de collègues avec qui l'on se sent en confiance.
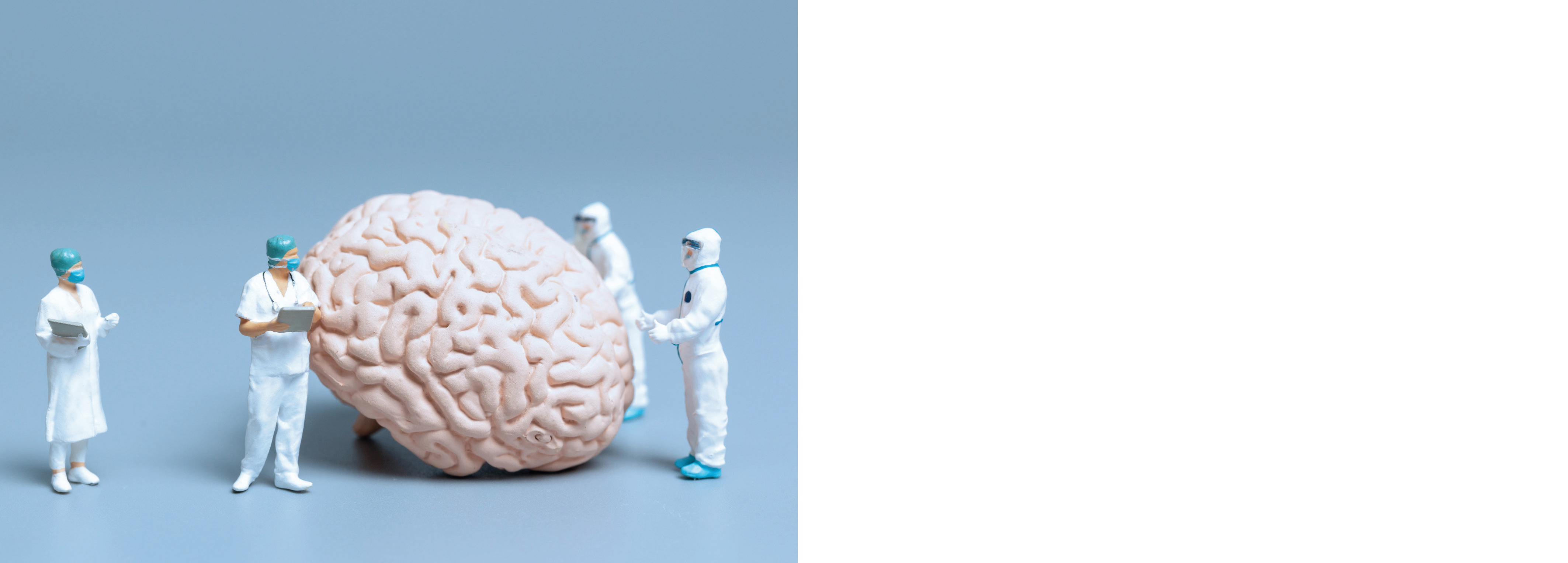
A. D.- Concernant l'enquête de l'ANAINF rapportée aux J2N de janvier 2024 sur l'attractivité des carrières, nous avons constaté que le désir de carrière universitaire diminue de moitié entre le début et la fin de l'internat, au profit notamment d'un poste de PH en CHG. Comment expliquer cette tendance ? Comment y remédier ?
PR I. S.- C'est une problématique extrêmement complexe et, si j'avais une réponse définitive, elle aurait déjà été publiée dans le JAMA ! Plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, l'internat en neurologie est exigeant, avec une charge de travail conséquente et un respect parfois limité du temps de travail réglementaire. Dans ces conditions, il est difficile de dégager du temps pour la recherche, ce qui peut décourager certains internes initialement intéressés par une carrière universitaire.
Ensuite, on observe une évolution des priorités chez les nouvelles générations d'internes, qui recherchent davantage un équilibre entre leur vie professionnelle et leur qualité de vie personnelle. Or, la carrière hospitalo-universitaire demande un investissement important, parfois perçu comme difficilement conciliable avec ces aspirations.
Par ailleurs, en progressant dans leur formation, les internes prennent conscience des contraintes inhérentes au statut de PU-PH. Les lourdeurs administratives, les responsabilités multiples et parfois le manque de reconnaissance peuvent en dissuader plus d'un. L'image renvoyée par certains PU-PH n'est pas toujours engageante, ce qui pousse certains internes à privilégier des structures plus légères, comme les centres hospitaliers généraux.
Enfin, l'incertitude sur l'évolution des statuts et des retraites joue également un rôle. Le cadre actuel, bien que susceptible d'évoluer avec les réformes en cours, reste perçu comme incertain.
Il est donc essentiel de mieux valoriser l'attractivité de la carrière universitaire en mettant en avant ses aspects stimulants et gratifiants. Nous devons parvenir à transmettre un message plus positif et à offrir des conditions plus propices à la conciliation entre engagement académique et équilibre personnel.
A. D.- Comment parvenez-vous à gérer l'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle ?
PR I. S.- J'y parviens essentiellement parce que j'aime ce que je fais et que mon entourage comprend mes engagements, sans jugement ni critique.
Cela dit, ma vie personnelle tourne beaucoup autour de la médecine. Je travaille souvent en soirée ainsi que les week-ends. Lorsque l'on cumule de nombreuses responsabilités, il est difficile de dégager de véritables temps de repos, mais l'intérêt du métier compense largement cette charge.
A. D.- En tant que PU-PH, quelles ont été les avancées majeures de ces dernières décennies et quels sont les défis à venir ?
PR I. S.- En Neurovasculaire, la thrombectomie a représenté une avancée révolutionnaire, transformant le pronostic fonctionnel des patients victimes d'AVC sévères. Dans les années à venir, grâce à de nouvelles techniques interventionnelles, nous espérons être capables d'extraire des thrombus de plus en plus distaux, ce qui permettra d'améliorer encore davantage le devenir des patients. La négativité des études récentes ne doit pas nous faire perdre espoir.
Les avancées thérapeutiques à venir concerneront également l'élaboration de nouvelles molécules pouvant limiter la mort neuronale en phase aiguë d'un AVC, notamment en bloquant certaines cascades inflammatoires délétères.
En ce qui concerne les maladies neurodégénératives, nous assistons à l'émergence de molécules anti-amyloïdes, bientôt suivies d'anti-tau et d'anti-alpha-synucléine. Ces thérapies, fondées sur des bases physiopathologiques solides, pourraient offrir de nouvelles solutions thérapeutiques. Cependant, la neurologie est une discipline complexe où la mise au point de traitements ciblés reste un défi majeur.
Les progrès réalisés dans la prise en charge de la sclérose en plaques ont également transformé l'évolution de cette maladie.
Globalement, la neurologie a profondément évolué : autrefois perçue comme une spécialité contemplative basée sur un examen clinique long et parfois imprécis, elle s'appuie désormais sur des examens complémentaires de haute précision et offre des perspectives thérapeutiques réelles.
A. D.- Quelle place accordez-vous à l'intelligence artificielle en neurologie ?
PR I. S.- L'intelligence artificielle apporte une aide précieuse, notamment dans l'analyse des images et des données sémiologiques fines. Elle ne remplace pas le raisonnement médical, mais constitue un outil d'aide à la décision. L'essentiel est d'apprendre à l'utiliser intelligemment, sans en devenir dépendant ni lui accorder une confiance aveugle. Nous ne sommes pas en compétition, mais en collaboration pour un avenir meilleur pour nos patients ; j'y crois énormément, je pense que c'est un atout indiscutable !

Alexandra DUPIC
Interne en 3ème semestre
Ile-de-France

