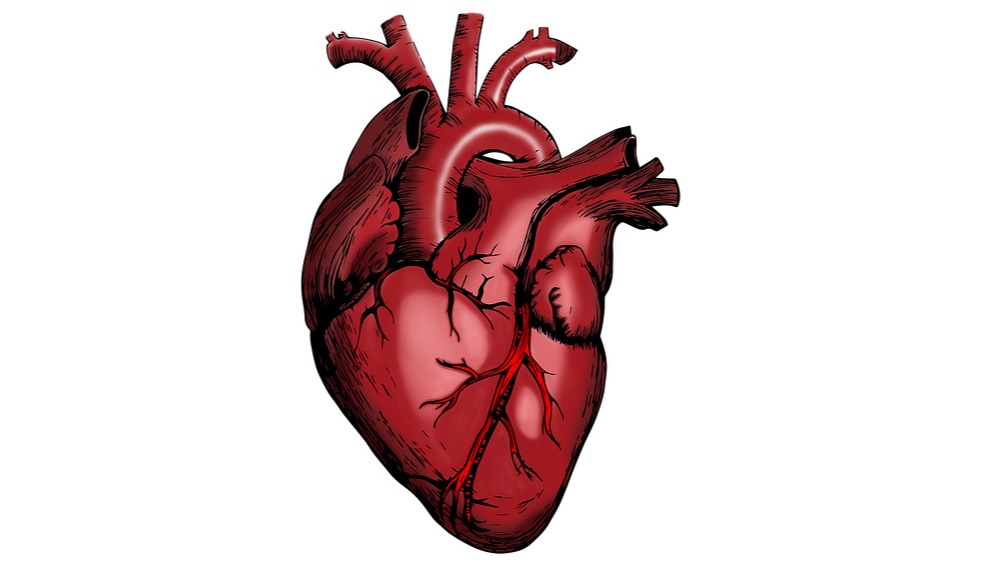
Introduction
L’endocardite infectieuse (EI) reste aujourd’hui un véritable défi de santé publique, grevée d’une importante morbi-mortalité avec près de 66 300 décès chaque année dans le monde1.
Un diagnostic précoce est crucial pour réduire les complications et le taux de mortalité autour de 20 % en intra hospitalier2.
Ces nouvelles recommandations viennent actualiser celles de 2015, en prenant compte de l’évolution épidémiologique, des nouveaux outils diagnostiques et des données thérapeutiques innovantes3.
Prévention
Le premier volet de ces recommandations est celui de la prévention.
On distingue 2 catégories particulièrement à risque :
Haut risque Risque intermédiaire • Antécédent d’endocardite infectieuse• Prothèses valvulaires*
• Cardiopathie congénitale cyanogène
• Assistance ventriculaire gauche • Valvulopathie rhumatismale
• Valvulopathie dégénérative
• Valvulopathie congénitale (dont bicuspidie)
• Dispositifs implantables
• Cardiomyopathie hypertrophique
* Ce groupe inclut les fermetures de CIA, d’auricule gauche, la pose de filtre cave et les pontages vasculaires dans les 6 mois suivant la procédure.
Pour tous ces patients, on rappelle l’importance de l’éducation thérapeutique sur les mesures générales de prévention des infections.
Il est suggéré de leur remettre une carte de synthèse (Figure 1) insistant sur les règles d’hygiène buccodentaire, la vigilance face aux portes d’entrées cutanées et surtout l’importance des prélèvements bactériologiques avant antibiothérapie.
Figure 1 : Carte de synthèse des mesures préventives de l’endocardite infectieuse,
d’après V.Delgado et al, EHJ 2023.
Chez les patients à haut risque, l’indication d’antibioprophylaxie est renforcée (I) en cas d’extraction dentaire, de chirurgie orale ou de procédure nécessitant une manipulation de la gencive ou de la région péri-apicale.
Elle peut désormais être considérée (IIb) chez les patients à haut risque en cas de procédure diagnostique ou thérapeutique à visée pneumologique, gastro-intestinale, génito-urinaire, cutanée ou musculosque-lettique.
On note que la clindamycine n’est plus recommandée en cas d’allergie à l’Amoxicilline, compte tenu du risque non négligeable d’évènement indésirable (notamment infections à Clostridium Difficile)4, 5.
Préférer la Céphalexine 2g ou Azithromycine/Clarithromycine 500 mg PO.
Avant les procédures de remplacement valvulaire percutané, une antibioprophylaxie ciblant l’Entérocoque et le Staphylocoque doré doit être envisagée (IIa).
Le dépistage nasal de portage de staphyloque est recommandé mais la décolonisation systématique sans dépistage nasal n’est pas recommandée (III)
Endocarditis Team
Ces nouvelles recommandations viennent asseoir la place de l’Endocarditis Team (IIa > I)
Constituée notamment de cardiologues, d’experts en imagerie cardiaque, de chirurgiens cardiaques, d’infectiologues, de microbiologistes, elle occupe une place centrale dans la gestion médico-chirurgicale des patients et a démontré son efficacité6, 7, 8.
Ainsi, on recommande de recourir à un centre médico-chirurgical de référence en valvulopathies dès le diagnostic d’endocardite infectieuse (I).
Une communication étroite avec l’Endocarditis Team doit être établie dès le début de la prise en charge. Il convient de transférer le patient en cas de complication.
Diagnostic
Imagerie multimodale
Dès les années 2000, les données cliniques, microbiologiques et d’imagerie ont été intégrées aux Critères de Duke Modifiés portant la sensibilité de ces critères à 80 %.
Mais la présentation de l’endocardite étant très variable, certaines limites ont été constatées notamment concernant les prothèses valvulaires qui sont de plus en plus fréquentes et dans lesquelles l’échographie peut être mise en défaut dans 30 % des cas d’endocardite infectieuse9.
Le recours à l’imagerie multimodale, intégrée dans les recommandations de 2015, s’est considérablement accentué.
Echographie
L’échographie transthoracique (ETT) reste l’examen de première intention lors de la suspicion diagnostique.
L’échographie transœsophagienne occupe désormais une place de choix (I) même en cas d’ETT positive pour le diagnostic d’endocardite, spécifiquement pour les endocardites du cœur gauche.
Elle est utile dans un large éventail de scénarios cliniques, en raison des limites de l’ETT pour le diagnostic de complications péri-valvulaires, des petites végétations ainsi que dans le contexte de valves prothétiques et de dispositifs implantables.
Il convient de la répéter aussi bien lors de la suspicion d’une complication, qu’au moment du switch de l’antibiothérapie intraveineuse pour une forme orale (I). Il y a lieu de la considérer même lors du suivi des formes simples, pour le dépistage de complication silencieuse (IIa).
Enfin, on soutient la réalisation d’une ETT/ETO à la fin de l’antibiothérapie pour réévaluer de la morphologie et la fonction valvulaires chez les patients non opérés (I).
Scanner
Ces nouvelles recommandations viennent entériner la place du scanner dans l’endocardite infectieuse.
Il est utile pour le diagnostic notamment pour confirmer le diagnostic d’une endocardite possible ou lorsque l’ETO est non concluante ou non réalisable10(I).
Plus précis que l’échocardiographie quant aux complications paravavulaires (abcès, pseudoanévrysmes, fistules), son impact est manifeste dans les décisions chirurgicales.
Le scanner a également un intérêt dans le bilan d’extension de l’endocardite.
En effet, le scanner corps entier (cervico-thoraco-ab-domino-pelvien) permet le diagnostic d’emboles septiques périphériques et éventuellement de source extracardiaque de bactériémie.
Ainsi, il est recommandé chez les patients présentant des symptômes extracardiaques (I).
Chez le patient asymptomatique, il peut être envisagé (IIb).
Sa valeur incrémentale au diagnostic réside dans l’adjonction d’un critère mineur en faveur d’endocardite infectieuse en cas d’embole périphérique.
Bien que l’IRM cérébrale soit plus performante pour le diagnostic des complications neurologiques, le scanner cérébral a l’avantage de l’accessibilité en urgence avec une précision acceptable11 (Sensibilité 90 % Spécificité 86 %).
Le coroscanner est présenté comme une alternative à la coronarographie préopératoire chez les patients à risque cardiovasculaire.
Il est préférable d’éviter la coronarographie en cas de végétation aortique même si elle reste possible chez certains patients sélectionnés (IIb).
On peut surseoir à l’évaluation des artères coronaires en cas d’urgence vitale (« emergency ») (IIa).
Le TEP scanner est une imagerie de choix pour compléter le diagnostic lorsque l’échocardiographie n’est pas concluante chez les patients porteurs de prothèse valvulaire (I) et avec dispositifs implantables (IIb).
Il peut être considéré chez ces patients même en post-opératoire précoce (<3 mois) avec un pattern d’inflammation spécifique focal et hétérogène en cas d’endocardite12. La scintigraphie aux leucocytes marquées est plus spécifique, en particulier en post-opératoire, mais d’accès plus restreint.
Le TEP scanner est utile également pour le bilan d’extension.
Enfin, il peut permettre de monitorer la réponse à l’antibiothérapie suppressive au long cours chez les patients à haut risque opératoire récusés de la chirurgie13.
Critères diagnostiques
L’entérocoque faecalis fait désormais partie des germes typiques d’endocardite infectieuse au sein du critère majeur (Duke modifié). Ainsi la sensibilité des critères passe de 70 à 96 %14.
On insiste sur les techniques de spectrométrie (MALDI-TOF) et biologie moléculaire (ARN 16S/18S) qui ont nettement amélioré les performances diagnostiques en cas d’hémoculture négative.
Les critères diagnostqiues, notamment d’endocardite « possible » ont été modifiés modifiés :
Critères majeursHémoculture positive
(a) Micro-organismes typiques de l'EI à partir de deux hémocultures distinctes :
Streptocoques oraux, Streptococcus gallolyticus (anciennement S. bovis), groupe HACEK, S. aureus, E. faecalis.
(b) Micro-organismes compatibles avec l'EI à partir d'hémocultures
continuellement positives.
(c) Une seule hémoculture positive pour C. burnetii ou IgG > 1/800.
Lésions anatomiques et métaboliques valvulaires, périvalvulaires/périprothétiques et de matériel étranger.
Par :
Echocardiographie (ETT/
ETO),
Scanner,
PET- scanner,
TEMP - scanner. Critères mineurs
1) Patient à risques intermédiaire ou haut,
2) Fièvre (T° > 38),
3) Embolies vasculaires (dont asymptomatiques),
4) Phénomènes immunologiques (facteur rhumatoïde, nodules d’Osler, tâches de Roth au fond d’oeil),
5) Preuve microbiologique :
> Hémoculture positive mais ne répondant pas à l'un des critères majeurs susmentionnés,
> Preuve sérologique d'une infection active par un organisme compatible avec l'IE. Diagnostic
• Certain : 2 majeurs ou 1 majeur + >=3 mineurs ou 5 mineurs,
• Possible : 1 majeur et >=1 mineur ou >=3 mineurs.
Critères diagnostiques modifiés de l’endocardite infectieuse.
Figure 2 : Algorithme diagnostique sur valve native, d’après V.Delgado et al, EHJ 2023.
Sur les valves prothétiques, on recommande le même algorithme en ajoutant les techniques d’imagerie nucléaire dans le cas de l’EI « possible ».
Thérapeutique
Traitement médical
La grande nouveauté de ces recommandations est le changement de paradigme du traitement intraveineux exclusif dans l’endocardite infectieuse.
En effet, l’étude POET a montré qu’après une phase initiale de traitement intraveineux, jusqu’à 20 % des patients pouvaient finir le traitement per os. Les résultats du suivi à 5 ans ont consolidé ces données chez des patients sélectionnés avec un suivi ambulatoire rapproché15.
Ainsi, il est possible de faire un relais per os de l’antibiothérapie (en alternative au traitement intraveineux extrahospitalier) pour les endocardites du cœur gauche à certaines bactéries (Streptocoque/E. faecalis/Staphylocoques), après un traitement intraveineux d’au moins dix jours (ou sept jours après la chirurgie) et après avoir éliminé la présence d’une complication en ETO (IIa).
Ce relais est néanmoins contre-indiqué (III) en cas de micro-organismes plus difficiles ou de terrain à risque (notamment cirrhose, toxicomanie) ou en cas de complications valvulaires.
Figure 3 : Antibiothérapie dans l’endocardite infectieuse, d’après V.Delgado et al, EHJ 2023.
Figure 4 : Algorithme pour le relais per os de l’antibiothérapie, d’après V.Delgado et al, EHJ 2023.
Chirurgical
Les complications de l’EI peuvent nécessiter une intervention chirurgicale, notamment en cas d’insuffisance cardiaque, de sepsis non contrôlé ou de prévention des embolies périphériques.
Désormais il peut être envisagé de recourir à la chirurgie lorsque la végétation mitrale ou aortique mesure plus de 10 mm, même en l’absence d’embolie ou d’une autre indication opératoire (IIb).
Le timing de la chirurgie diffère selon l’indication : Emergency = chirurgie dans les 24h.
Urgent = chirurgie dans les 3 à 5 jours.
Non urgent = pendant l’hospitalisation.
Figure 5 : Timing chirurgical dans l’endocardite infectieuse, d’après V.Delgado et al, EHJ 2023.
Malgré les risques de la chirurgie chez ces patients souvent à haut risque chirurgical, il a été montré une augmentation de la survie à 1 an de 20 % comparativement au traitement médical seul16, 17.
En cas d’accident vasculaire cérébral ischémique, il n’est pas recommandé de différer l’intervention chirurgicale en l’absence de coma ou de transformation hémorragique à l’imagerie cérébrale (I).
À noter que la thrombectomie mécanique peut être considérée lorsqu’elle est disponible dans le centre (IIb). La thrombolyse reste contre-indiquée.
La chirurgie doit également être considérée après discussion multidisciplinaire en cas d’hémorragie intracrânienne et d’indication chirurgicale urgente (IIa).
Lorsqu’elle n’est pas urgente, le délai est de 1 mois.
Enfin, la règle reste l’arrêt des antiagrégants plaquettaires et des anticoagulants en cas de saignement majeur.
La chirurgie est recommandée en cas d’infection précoce de prothèse valvulaire (<6 mois) avec remplacement valvulaire et débridement complet (I).
L’extraction des dispositifs implantables est primordiale en cas de végétation visualisée (I).
et doit être envisagée même en l’absence de greffe bactérienne certaine, en fonction du germe et de l’indication opératoire (IIa).
La réimplantation du nouveau dispositif doit se faire sur un autre site, aussi tard que possible, une fois le sepsis contrôlé et les hémocultures négatives depuis au moins 72h en l’absence de végétation et 2 semaines si une végétation était visualisée (I).
Endocardites du cœur droit
En cas d’EI sur valve tricuspide, la chirurgie est désormais indiquée si :
- Insuffisance tricuspide sévère avec réponse diurétique inadaptée (I) ;
- Insuffisance respiratoire nécessitant une assistance sur végétation embolique (I) ;
- Végétation de plus de 20 mm embolique (I) ;
- Atteinte du cœur gauche associée (I) ;
- Persistance de sepsis après 1 semaine d’antibiothérapie adaptée (IIa).
Il faut privilégier la réparation lorsqu’elle est possible, plutôt que le remplacement valvulaire (IIa). avec l’implantation prophylactique d’un stimulateur cardiaque épicardique d’emblée (IIa).
Les points clés à retenir
- Importance de la prévention et nouvelles indications de l’antibioprophylaxie ;
- Rôle renforcé de l’Endocarditis Team pour une gestion pluridisciplinaire des patients ;
- Place centrale de l’imagerie multimodale aux différentes étapes de la prise en charge ;
- Nouveaux critères diagnostiques et endocardite « possible » ;
- Relais per os de l’antibiothérapie dans les formes simples ;
- Extension des indications chirurgicales : prévention embolique, prothèses valvulaires et chirurgie tricuspide.
Références
- Momtazmanesh S, Saeedi Moghaddam S, Malakan Rad E, Azadnajafabad S, Ebrahimi N, Mohammadi E, et al. Global, regional, and national burden and quality of care index of endocarditis: the global burden of disease study 1990–2019. Eur J Prev Cardiol 2022;29: 1287–1297.
- Habib, G., Erba, P. A., Iung, B., Donal, E., Cosyns, B., Laroche, C., ... & Lancellotti, P. (2019). Clinical presentation, aetiology and outcome of infective endocarditis. Results of the ESC-EORP EURO-ENDO (European infective endocarditis) registry: a prospective cohort study. European heart journal, 40(39), 3222-3232.
- V.Delgado et al, 2023 ESC Guidelines for the Management of Endocarditis, European Heart Journal 2023, 00, 1-95.
- Thornhill MH, Dayer MJ, Durkin MJ, Lockhart PB, Baddour LM. Risk of Adverse Reactions to Oral Antibiotics Prescribed by Dentists. Journal of Dental Research. 2019;98(10):1081-1087.
- Cloitre, A., Duval, X., Tubiana, S., Giraud, P., Veyrac, G., Nosbaum, A., ... & Lesclous, P. (2019). Antibiotic prophylaxis for the prevention of infective endocarditis for dental procedures is not associated with fatal adverse drug reactions in France. Medicina Oral, Patologia Oral y Cirugia Bucal, 24(3), e296.
- Elad, B., Perl, L., Hamdan, A., Yahav, D., Atamna, A., Shaked, H., ... & Orvin, K. (2022). The clinical value of the endocarditis team: insights from before and after guidelines implementation strategy. Infection, 50(1), 57-64.
- Chirillo, F., Scotton, P., Rocco, F., Rigoli, R., Borsatto, F., Pedrocco, A., ... & Olivari, Z. (2013). Impact of a multidisciplinary management strategy on the outcome of patients with native valve infective endocarditis. The American Journal of Cardiology, 112(8), 1171-1176.
- El-Dalati, S., Cronin, D., Riddell IV, J., Shea, M., Weinberg, R. L., Washer, L., ... & Deeb, G. M. (2022). The clinical impact of implementation of a multidisciplinary endocarditis team. The Annals of thoracic surgery, 113(1), 118-124.
- Hill, E. E., Herijgers, P., Claus, P., Vanderschueren, S., Peetermans, W. E., & Herregods, M. C. (2007). Abscess in infective endocarditis: the value of transesophageal echocardiography and outcome: a 5-year study. American heart journal, 154(5), 923-928.
- Sifaoui, I., Oliver, L., Tacher, V., Fiore, A., Lepeule, R., Moussafeur, A., ... & Deux, J. F. (2020). Diagnostic performance of transesophageal echocardiography and cardiac computed tomography in infective endocarditis. Journal of the American Society of Echocardiography, 33(12), 1442-1453.
- Goddard, A. J. P., Tan, G., & Becker, J. (2005). Computed tomography angiography for the detection and characterization of intra-cranial aneurysms: current status. Clinical radiology, 60(12), 1221-1236.
- Scholtens, A. M., Swart, L. E., Verberne, H. J., Tanis, W., Lam, M. G., & Budde, R. P. (2016). Confounders in FDG-PET/CT imaging of suspected prosthetic valve endocarditis. JACC: Cardiovascular Imaging, 9(12), 1462-1465.
- Erba, P. A., Lancellotti, P., Vilacosta, I., Gaemperli, O., Rouzet, F., Hacker, M., ... & Habib, G. (2018). Recommendations on nuclear and multimodality imaging in IE and CIED infections. European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 45, 1795-1815.
- Dahl, A., Fowler, V. G., Miro, J. M., & Bruun, N. E. (2022). Sign of the times: updating infective endocarditis diagnostic criteria to recognize Enterococcus faecalis as a typical endocarditis bacterium. Clinical Infectious Diseases, 75(6), 1097-1102.
- Pries-Heje, M. M., Wiingaard, C., Ihlemann, N., Gill, S. U., Bruun, N. E., Elming, H., ... & Bundgaard, H. (2022). Five-year outcomes of the Partial Oral Treatment of Endocarditis (POET) trial. New England Journal of Medicine, 386(6), 601-602.
- Iung, B., Doco-Lecompte, T., Chocron, S., Strady, C., Delahaye, F., Le Moing, V., ... & Hoen, B. (2016). Cardiac surgery during the acute phase of infective endocarditis: discrepancies between European Society of Cardiology guidelines and practices. European heart journal, 37(10), 840-848.
- Østergaard, L., Oestergaard, L. B., Lauridsen, T. K., Dahl, A., Chaudry, M., Gislason, G., ... & Fosbøl, E. L. (2018). Long-term causes of death in patients with infective endocarditis who undergo medical therapy only or surgical treatment: a nationwide population-based study. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 54(5), 860-866.
Alexandre PFEFFER
Membre du CCF
Paris
Auteur
Pr Bernard IUNG
Paris
Relecteur
Article paru dans la revue « Le magazine des jeunes cardiologues - Collège des Cardiologues en Formation » / CCF N° 19

