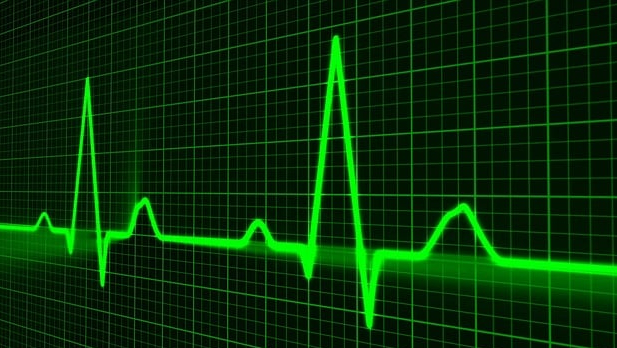
Tout savoir sur les atteintes cardiaques de la Sclérodermie systémique
La sclérodermie systémique est une connectivité d’origine auto-immune se caractérisant par une vasculopathie et une fibrose de la peau mais pouvant toucher tous les organes. Il s’agit d’une maladie rare (5 à 25 cas pour 100.000 habitants), touchant préférentiellement les femmes (en moyenne 8 femmes pour 1 homme) avec un pic entre 45 et 60 ans. Il s’agit d’une maladie handicapante greffée d’une particulière gravité avec un taux de survie à 10 ans entre 60 et 80 %. La prévalence de l’atteinte cardiaque est difficile à déterminer (7 à 40 % selon les études), compte-tenu de l’absence de définition consensuelle, de la diversité des manifestations, d’une longue phase asymptomatique, des différentes méthodes diagnostiques utilisées de la diversité des populations dans les études, des différences entre les résultats des études histologiques et cliniques et des diagnostics différentiels.
L’atteinte cardiaque représenterait plus du 1/3 des causes de mortalité. On distingue l’atteinte cardiaque primaire, liée à la maladie, et secondaire, liée aux atteintes respiratoire (fibrose interstitielle), l’hypertension pulmonaire (HTP) et l’atteinte rénale.
Physiopathologie et nosologie de la Sclérodermie systémique
La sclérodermie associe 3 composantes physiopathologiques.
• Une microangiopathie mettant en jeu une activation endothéliale exacerbée via une sécrétion accrue d’endothéline. Ceci aboutit à une vasoconstriction et à une activation fibroblastique aboutissant à une oblitération des petits vaisseaux, pouvant expliquer le phénomène de Raynaud coronaire (vasospasme des artérioles coronaires) mais aussi l’HTAP.
• La voie de l’hypoxie (HIF) et de l’angiogenèse (VEGF) sont également activées aboutissant à une angiogenèse inefficace et à la création de mégacapillaires.
• La fibrose, par dépôts de matrice extracellulaire, est secondaire à l’activation fibroblastique en myofibroblaste et à l’activation de la voie du TGF béta, à l’origine des dépôts en excès de collagène dans tous les tissus, y compris les vaisseaux et le myocarde.
Enfin, la composante autoimmune, avec synthèse d’autoanticorps (anti centromères, anti Scl 70, anti ARN Polymérase III), associée à une composante cellulaire immune (voie de l’interféron de type 1, lymphocytes T CD4) qui mènent à une réaction autoimmune ciblant l’endothélium, pérennisant ainsi la maladie.
Il existe différentes formes de sclérodermie sans continuum particulier :
Atteintes non cardiaques de la sclérodermie systémique
La présentation clinique de la sclérodermie systémique est dominée par la fibrose cutanée et viscérale. L’atteinte cutanée (quantifiée par le score de Rodnan) est un reflet possible des atteintes systémiques. Le syndrome de Raynaud, secondaire à une atteinte vasculaire est quasi constant. La composante vasculaire concerne également les reins avec une atteinte aiguë potentiellement grave, la crise rénale sclérodermique (atteinte vasculaire pure sans atteinte glomérulaire) mais aussi une atteinte des artères pulmonaires. La fibrose touche préférentiellement les poumons avec une pneumopathie interstitielle non spécifique mais aussi la totalité du tube digestif avec un RGO pouvant aboutir à une œsophagite et à une constipation chronique via la POIC (pseudo obstruction intestinale chronique).
Atteintes cardiaques de la sclérodermie systémique
La sclérodermie systémique peut toucher les 3 tuniques cardiaques mais aussi les vaisseaux (artères, artérioles).En fonction des différentes méthodes de screening et de diagnostic, sa prévalence est estimée entre 15 et 35 % (10 à 30 % avec une symptomatologie cardiovasculaire mais plus de 70 % asymptomatique). Les études de cohortes et cas-témoins ont mis en évidence différents facteurs de risque associés à la survenue d’une atteinte cardiaque, listés ci-dessous.
La physiopathologie de l’atteinte cardiaque met en jeu différents mécanismes :
• Atteinte de la microcirculation coronaire.
• Inflammation myocardique et péricardique.
• HTAP primitive et/ou secondaire.
• Secondaire via une atteinte rénale (syndrome cardiorénal).
Atteinte myocardique
L’atteinte des artères coronaires perforantes et des artérioles aboutit à des lésions d’ischémiereperfusion menant à l’apoptose cardiomyocytaire puis à une fibrose de remplacement sousendocardique (ne répondant pas à une topographie coronaire). De plus, une symptomatologie d’angor est possible via un mécanisme RaynaudLike (vasospasme).
Le remodelage cardiaque délétère associée à une fibrose plus ou moins diffuse aboutissent à une baisse de la compliance ventriculaire gauche et à une majoration de sa « rigidité ».
Enfin, l’inflammation chronique à bas bruit secondaire à la connectivite (en dehors des poussées) contribue à l’atteinte myocardique et du système cardionecteur. Des myocardites aiguës ou subaiguës sont possibles, plus fréquemment associée à une myosite systémique dans un contexte de syndrome de chevauchement (sclérodermie systémique et polymyosite).
Une interrogation sur le lien entre la sclérodermie et l’atteinte macrovasculaire a été soulevée. Certaines études ont rapporté une augmentation de la prévalence de la cardiopathie ischémique chez des patients porteurs d’une sclérodermie systémique malgré un nombre moindre de facteurs de risque cardiovasculaires ainsi qu’un score calcique coronaire plus élevé.
>Insuffisance cardiaque à FEVG préservée
L’atteinte myocardique est à l’origine d’une insuffisance cardiaque à FEVG préservée, associée à un excès de morbimortalité.
Dans une étude de l’EULAR (European League Against Rheumatism) incluant 7073 patients, la prévalence d’une FEVG < 55 % était de 5,4 %, et significativement associée aux atteintes rénale et pulmonaire (fibrose et HTP).L’atteinte myocardique se traduit le plus souvent par une dysfonction diastolique asymptomatique pouvant toucher les 2 ventricules, présente chez 40 à 80 % des patients, et d’autant plus fréquente que la sclérodermie évolue au long cours. Cette dysfonction diastolique est asymptomatique évoluant très progressivement vers une insuffisance cardiaque congestive.
Une échocardiographie normale n’élimine pas l’atteinte cardiaque liée à la sclérodermie. Cette dernière se caractérise par un remodelage cardiaque, hypertrophie ventriculaire gauche prédominant sur le septum interventriculaire, et un retentissement hémodynamique, pressions de remplissage du VG élevées avec un profil mitral de type restrictif ou trouble de la relaxation associée à une vitesse maximale de l’insuffisance tricuspide > 2,8 m/s. La dysfonction systolique, définie par une FEVG < 50 %, n’est présente que dans 5 % des cas et un stade tardif. La mesure précoce de l’onde S mitrale en doppler tissulaire dont la baisse serait précoce pourrait avoir un intérêt dans le dépistage précoce.
Une ETT normale n’élimine pas l’atteinte cardiaque liée à la sclérodermie.
Des études récentes mettent en évidence une baisse précoce du strain longitudinal global et cela dès le stade asymptomatique. Dans une étude italienne, chez des patients ayant une sclérodermie systémique, la baisse précoce du strain longitudinal global est associée à la survenue de fibrillation atriale et d’une mortalité cardiovasculaire précoce ainsi qu’à des taux plus importants d’anticorps anti Scl70.Une atteinte ventriculaire droite est fréquente (30 à 40 % des cas, sans HTAP obligatoire) mise en évidence à l’échographie par une fraction raccourcissement VD < 45 %, une baisse du TAPSE et des anomalies du Strain VD.
L’IRM est désormais considérée comme la technique de référence en imagerie pour évaluer la structure et la fonction cardiaques en raison de son excellente résolution spatiale en particulier pour l’évaluation du ventricule droit. L’IRM de stress peut de plus détecter des anomalies microvasculaires coronaires chez ces patients.
Elle est également très utile pour la caractérisation tissulaire et différencie de manière fiable l’inflammation du myocarde de la fibrose en plus des défauts de perfusion précoces (via le T1 mapping et la mesure du volume extracellulaire). Dans une étude rétrospective, les patients présentant un rehaussement tardif au gadolinium (LGE), révélateur d’une fibrose myocardique focale, avaient un surrisque d’arythmie et de dysfonction VG. Enfin, un profil d’atteinte de réhaussement au LGE de type patchy médiomyocardique (contrairement à l’atteinte coronaire sous endocardique) des segments basal et moyen du VG a été décrit. Des troubles microcirculatoires avec ou sans vasospasme peuvent être documentés aussi en imagerie nucléaire par scintigraphie au Thallium.
>Troubles du Rythme et de la conduction
ls représentent une complication fréquente de la sclérodermie, comme montré dans l’étude de Nordin et al portant sur 110 patients bénéficiant d’ECG et d’HolterECG et qui rapportait 38 % de troubles du rythme et 15 % de troubles de conduction. L’œdème myocardique, la fibrose et l’atteinte microcirculatoire expliquent les anomalies électriques (entre 10 et 50 %) décrites chez les patients atteints de sclérodermie systémique.
Les troubles de conduction les plus fréquents sont le bloc de branche gauche et le BAV1. À noter que la survenue de novo d’un bloc de branche droit serait un facteur de risque de mortalité. Les tachyarythmies supraventriculaires symptomatiques ont tendance à être plus fréquentes que les bradyarythmies. Les arythmies ventriculaires sont moins fréquentes mais sont associées à un risque accru de mort subite, en particulier lorsqu’elles sont concomitantes d’une atteinte myocardique (via une myocardite aiguë ou subaiguë) et surtout en cas d’altération de la FEVG.
Ces atteintes peuvent s’associer à une dysautonomie, fréquente, survenant aux stades précoces du processus de la maladie qui précèderait le développement de la fibrose myocardique. L’absence de variabilité de la fréquence cardiaque et la tachycardie au repos seraient associées à une mortalité accrue dans la sclérodermie systémique.
Atteintes du péricarde et de l’endocarde
>Péricardites
L’atteinte péricardique est très fréquente, estimée entre 30 et 70 %, mais l’épanchement péricardique est le plus souvent de découverte fortuite. Néanmoins, la péricardite est symptomatique dans 5 à 15 % des cas. Plus rarement, la péricardite évolue vers la chronicité, lorsque la maladie de fond n’est pas contrôlée. Dans une cohorte japonaise, cette atteinte est associée à la survenue d’une crise rénale sclérodermique avec comme facteur potentiel confondant la prise de corticoïdes. Une atteinte constrictive est rare mais possible, dépistée en ETT (variations respiratoires des flux mitral et tricuspide) et pouvant être diagnostiquée également à l’IRM cardiaque (variation > 25 % du flux mitral à l’inspiration). Le traitement de la péricardite ne diffère pas des autres causes, hormis l’abstention de prescription des corticoïdes, associées au risque accru de survenue, d’une crise rénale sclérodermique.
>Atteinte valvulaire
L’atteinte mitrale semble la plus fréquente à type de prolapsus valvulaire avec épaississement des feuillets, probablement secondaire à un excès de fibrose endocarditique, mais cette atteinte fréquente en population n’est pas spécifique. À noter une incidence plus importante de sténose aortique sévère dans cette population avec une implication décisionnelle. En effet, du fait d’une atteinte cutanée thoracique importante avec syndrome restrictif pulmonaire, la sternotomie est le plus souvent difficile, et après confrontation multidisciplinaire, le TAVI semble être à considérer en 1ère intention.
Hypertension pulmonaire
L’hypertension pulmonaire (HTP) qu’elle soit primitive (HTAP) ou secondaire, dépasse le cadre de cet article. L’HTAP, pour être présente nécessite une altération microangiopathique de plus de 50 % du lit vasculaire pulmonaire. Elle est plus fréquente dans l’atteinte cutanée limitée plus ou moins associée à une maladie veinoocclusive. Chez les patients asymptomatique, un dépistage annuel par ETT et EFR est nécessaire, avec en cas de présence d’une fuite tricuspide importante invalidant la mesure non invasive des pressions pulmonaires, la nécessité de réaliser un cathétérisme cardiaque droit pour confirmer le diagnostic. Elle est associée à une morbimortalité très importante (survie à 3 ans de 60 %).
L’HTP peut être secondaire, postcapillaire de type 2 en cas d’altération de la fonction diastolique diastolique VG, voire de type 3 si une atteinte pulmonaire parenchymateuse sévère est présente et est alors de très mauvais pronostic.
Screening de l’atteinte cardiaque
Traitements et perspectives
L’atteinte myocardique diastolique est traitée par antagonistes calciques dihydropyridiques tels que la nicardipine ou nifédipine (amélioration de la réserve coronaire) qui ont aussi une indication dans le phénomène de Raynaud. À noter que les bétabloquants sont à éviter en particulier les Béta 1 sélectifs.
La myocardite aiguë se traite par immunosupresseurs avec initialement des corticoïdes puis de l’azathioprine, du mycophénolate mofétil (Cellcept) ou du cyclophosphamide. Il est important de souligner qu’à de fortes doses, myéloablatives, utilisées dans les formes pulmonaires sévères, le cyclophosphamide (Endoxan) est dépresseur cardiaque pouvant aboutir à des dysfonctions biventriculaires.
L’autogreffe de cellules souches périphériques développé à l’hôpital St Louis est en pleine expansion, avec pour principale indication les sclérodermies systémiques diffuses d’évolution viscérale rapidement progressive. Là aussi, lacardiotoxicité de la chimiothérapie d’induction préalable, nécessite une évaluation cardiooncologique spécialisée.Le traitement de l’HTAP cible la voie de l’endothéline, des prostacyclines et du NO avec des associations possibles, précisées dans les recommandations publiées dans cette pathologie.
Conclusion
• L’atteinte Cardiaque n’est pas rare et potentiellement létale.
• L’atteinte des 3 tuniques est possible (péricarde = myocarde > endocarde).
• La dysfonction diastolique du VG est l’atteinte la plus fréquente.
• L’apport de l’IRM est prometteur en sus de l’ETT systématique.
• Un dépistage précoce permettrait de diminuer l’incidence de l’insuffisance cardiaque.
• Il n’y a pas de traitement spécifique.
Références
Généralités
• Jaeger VK et al. Incidences and Risk Factors of Organ Manifestations in the Early Course of Systemic Sclerosis: A Longitudinal EUSTAR Study. PloS One. 2016;11(10):e0163894
• Denton C P et al, Lancet, 2017: S01406736(17)309339
• Nihtyanova S, et al, Arthritis Rheumatol. (2014) 66:162535. doi: 10.1002/art. 38390
• PNDS 2017, Luc Mouthon
• Traité de Médecine Interne Editions Lavoisier (mettre les pages, l’édition avec l’année)
• Kahan A et al.. Rheumatology (Oxford) 2009;48(Suppl 3):iii45–8.
• Ferri C et al. Medicine (Baltimore) 2002;81(2):139–53
• Elhai M et al. Rheumatology (Oxford) 2012;51(6):1017–26.
• Hachulla E et al.. Rheum Dis 2009;68: 1878–84.
• Steen VD et al.. Arthr Rheum 1988;31: 196–203.
Atteintes Myocardiques
Insuffisance cardiaque
• Steen VD et al.. Arthr Rheum 1988;31: 196–203.
• Parks JL et al.. Rheum Dis Clin N Am 2014; 40: 87–102
• Cusmà Piccione M. et al. Cardiovascular Ultrasound 2013, 11:6
• Meune C et al. Semin Arthritis Rheum. 2016;45:43945.
• Spethmann S et al. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2012 ; 13 : 86370
• De Groote et al, Ann Rheum Dis 2009;68:1878–1884
• Rangarajan V et al.Curr Opin Rheumatol. 2017 Nov;29(6):574584, 2017 10408711
• Hromá dka M. et al. / Int J Cardiol 2017; 249;448–453
• De Luca G. et al. Rheumatology 2022;00:1–11
Anomalies électriques
• Roberts NK et al. Ann Intern Med 1981;94:38–40. doi:
• Parks JL et al Rheum Dis Clin North Am. 2014;40(1):87. Epub 2013 Nov 7.
• Othman KM et al. Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord 2010; 3:43.
• Nordin A et al. Scand J Rheumatol. 2 014;43 (3):2215
• PéricarditesMcWhorter JE, Am J Med. 1974;57(4):566.
• Cosyns B et al, Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015;16(1):12.
Atteintes Valvulaires
• FernándezCodina A. Rheumatol Int. 2017;37:7584.
• Kurmann RD et al. J Rheumatol. 2021 Jul;48(7):10471052
• Ayhan H et al. .Acta Cardiol Sin. 2021 Jan;37(1):3846
Screening et traitement
• PNDS 2017, Mouthon L. et al.
• Traité de Médecine Interne Editions Lavoisier
• Bissell LA et al. Management of cardiac disease in systemic sclerosis. Rheumatol Oxf Engl. 2017;56(6):91221
• Glynn P et al. Front. Cardiovasc. Med. 9:846213. doi: 10.3389/fcvm.2022.846213
Raphaël COHEN
Interne en Cardiologie et
étudiant en thèse de science (INSERM U970, Team 5)
Relecteur expert
Pr Ariel COHEN
Chef de service de cardiologie
à l’Hôpital Saint-Antoine (APHP, Paris)
Article paru dans la revue “ Collèges des Cardiologues en Formation ” / CCF n°17

